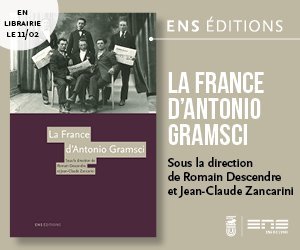Un vent de réaction souffle sur la vie intellectuelle
Un vent de réaction souffle sur la France. Il se manifeste dans bien des domaines de la vie politique, du repli sur une identité nationale à l’appel à des mesures toujours plus sécuritaires. Mais il n’épargne plus désormais la vie intellectuelle. Il s’y manifeste par une série d’attaques pas nécessairement coordonnées, mais assurément convergentes, menées par une alliance objective entre gens de pouvoir et gens de savoir. Il s’y exprime par un rejet de courants qui ne sont pas toujours précisément définis et dont les membres, du reste, sont loin de partager les mêmes positions.
La cible de cette réaction est en effet un ensemble composite qui mêle questions ethnique et raciale, études de genre et de sexualité, postcolonial et décolonial, intersectionnalité, et désormais la chimère de l’islamo-gauchisme, voire pour certains l’écriture inclusive. On parle souvent, pour qualifier cette collection hétérogène, de politiques identitaires.
Sont aussi visés, parfois nommément, plus souvent allusivement, celles et ceux qui traitent de ces sujets, en recourant ici à la dérision, là à la dénonciation, toujours à la caricature et, bien sûr, à la référence à l’influence états-unienne. Car, pour ces contempteurs, c’est des États-Unis, ou plutôt des campus états-uniens, que viendrait le mal, en méconnaissance du fait que, si l’on doit en effet le féminisme intersectionnel à Kimberle Crenshaw et la performativité du genre à Judith Butler, le domaine scientifique des études ethniques et raciales a d’abord été développé en Grande-Bretagne, de Michael Banton et John Rex à Stuart Hall et Paul Gilroy, certes tous lointains héritiers de W. E. B. Du Bois, tandis que ce sont le Palestinien Edward Said et avant lui le Martiniquais Frantz Fanon qui ont théorisé le postcolonial, et que le Péruvien Aníbal Quijano et l’Argentin Walter Mignolo sont à l’origine de la pensée décoloniale.
Il y a de l’obsession mais aussi de l’ignorance dans la diabolisation des États-Unis, et c’est une c