La distinction entre science engagée et idéologie : les leçons de Bourdieu
La polémique déclenchée – à juste titre – par les accusations récentes d’islamo-gauchisme proférées par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal contre les chercheures en sciences humaines et sociales en France a remis à l’ordre du jour la question des rapports entre science et idéologie.
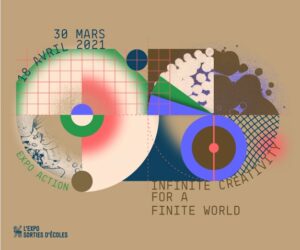
La ministre, qui est une biologiste, voit dans l’usage des notions de « race » et de « genre » comme dans celle d’« intersectionnalité » l’expression d’une idéologie plutôt que d’une démarche scientifique. Sans revenir sur la polémique et les travaux sur les usages de cette notion d’islamo-gauchisme (notamment celui de David Chavalarias qui a montré son instrumentalisation politique par la droite contre La France Insoumise), on se propose ici de réfléchir à ce qu’est une science engagée et en quoi elle se distingue d’une idéologie, en s’appuyant sur la relecture de Travail et travailleurs en Algérie (Mouton, 1963), dont la deuxième partie, rédigée par Pierre Bourdieu, reparaît aux éditions Raisons d’Agir, dans une édition établie avec soin par Amín Peréz et mise en perspective par des documents annexes et une postface de Tassadit Yacine.
Dans l’avant-propos du livre, Bourdieu revient sur les conditions d’une recherche menée en situation coloniale. Selon lui, l’idée qu’une telle recherche serait nécessairement « affectée d’une impureté essentielle » relève de l’idéologie. Il cite, à cet effet, Michel Leiris pour qui l’ethnographie est, plus encore que d’autres disciplines, entachée de cette impureté du fait qu’elle tient sa mission de l’État colonial, ce qui interdit à l’ethnographe de s’en défausser.
C’est a fortiori le cas, explique Leiris dans « L’ethnographe devant le colonialisme » en 1950, lorsqu’elle travaille dans des territoires coloniaux dépendants de son pays d’origine, même sans recevoir d’aide directe de son gouvernement, car les enquêtés ne peuvent que l’assimiler à l’administration coloniale. Et Bourdieu de commenter : « On
