Recadrer l’épidémie de Covid-19 depuis la société et son espace
La pandémie de Covid-19 a été très diversement abordée par les gouvernements, mais la majorité, dans le monde dit « occidental » (Europe, Amériques, Océanie), a choisi des stratégies de mitigation, plutôt que d’élimination du virus. Les données disponibles sont d’une part provisoires, la pandémie n’étant pas achevée, et d’autre part ne sont pas toutes élaborées sur les mêmes bases. Néanmoins on constate à ce jour (mars 2021) que ces stratégies aboutissent à des taux de mortalité d’ordre de grandeur comparable pour un grand nombre de ces pays : plus de 1 600 décès dus au Covid-19 par million d’habitants aux États-Unis et en Italie, plus de 1 800 au Royaume-Uni, plus de 1 300 en France et au Brésil, près de 1 500 au Mexique et au Pérou, selon les statistiques de Worldometers au 14 mars 2021.
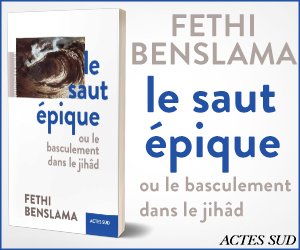
L’Allemagne, dont la gestion a été citée en exemple lors du premier confinement, déplore tout de même plus de 800 morts par Covid-19 par million d’habitants. Le contraste est net avec les pays ayant choisi une stratégie « Zéro Covid » : l’Australie compte 35 morts dus à la Covid-19 par million d’habitants et la Nouvelle-Zélande, 5. Certes, l’insularité joue certainement, mais pour des îles comme la Guadeloupe le taux de décès par Covid-19 par million d’habitants est néanmoins de plus de 400, pour la Martinique de plus de 100 ; et la Réunion, bien qu’un peu moins affectée selon ce même indicateur, se trouve aujourd’hui en difficulté face aux nécessités d’hospitalisation.
Dans les pays où la contamination est forte, aux conséquences directes de l’épidémie, s’ajoute la déprogrammation de rendez-vous médicaux et d’actes chirurgicaux et plus globalement le déficit de prise en charge des autres maladies. En outre, un nombre important de personnes ont été confrontées à des formes assez graves de la maladie elle-même et à ses séquelles, ainsi qu’au décès brutal et imprévu de proches, d’amis, de connaissances et de patients. Plus généralement, du fait d’une diversité de facettes
