Le Pen, les sondages et la présidentielle
Et c’est reparti pour un tour. À un an de l’échéance présidentielle de 2022, les médias bruissent déjà de résultats de sondages annonçant Marine Le Pen première au premier tour avec 25 à 28 % d’intentions de vote (selon les hypothèses de candidature testées), et au « coude-à-coude » avec Emmanuel Macron au second (44 % à 47 % au second tour contre 56 % à 53 %) [1]. Ainsi, comme avant chaque scrutin, la machine à spéculer sur les scores du Front National/Rassemblement National ou de ses candidats s’est remise en marche, générant, comme à chaque fois, un inévitable buzz. On peut cependant douter de la valeur de ces estimations, pour au moins trois raisons.
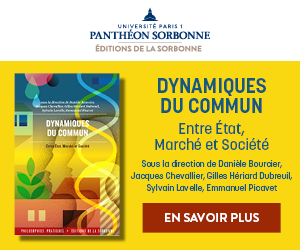
La première, la plus évidente, réside dans le caractère virtuel du rapport de forces qu’enregistrent les enquêtes qui sont réalisées actuellement. Virtuel car on demande aux personnes interrogées de se prononcer sur une élection qui aura lieu dans douze mois (et non « dimanche prochain », comme formulé dans la question qui leur est posée), et alors qu’interviendront entre temps les élections régionales [2]. Virtuel car la plupart des candidats testés dans les enquêtes ne sont même pas encore déclarés. Virtuel car à ce stade, les répondants sont encore en grande majorité indécis, qu’il s’agisse de leur éventuelle participation à l’élection ou de leur choix politique. On ne peut même pas dire que le sondage offre ici une « photographie de l’opinion », comme aiment à le répéter certains commentateurs, puisque cette opinion est en l’occurrence purement et simplement fabriquée : elle est artefactuelle.
La deuxième tient à la fragilité du caractère représentatif des échantillons sondagiers. Au niveau sociodémographique, les échantillons « bruts » recueillis à l’issue des phases d’enquête présentent en général un nombre toujours moins important d’ouvriers, de salariés et de personnes non diplômées, et un nombre toujours plus important de cadres et de professions intellectuelles que dans la population globale. Au
