Santé publique et capitalisme pharmaceutique
Depuis plus d’un siècle, une technologie – le médicament – a pris une place croissante dans les soins de santé et dans les espoirs que les sociétés placent dans la médecine. Si les traitements médicamenteux des malades du Covid-19 ont été porteurs de désillusions, la mise au point, en quelques mois seulement, de plusieurs vaccins préventifs contre cette maladie, basés sur des mécanismes d’action différents et remarquablement efficaces, est une démonstration de force de la recherche pharmaceutique et ne peut que participer à conforter cette centralité du médicament dans la médecine.
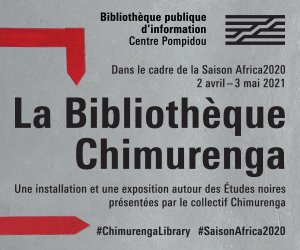
Ce domaine pharmaceutique est cependant marqué depuis plusieurs décennies par des tensions fortes et persistantes entre, d’un côté, les objectifs de santé publique et, de l’autre, les stratégies des grands groupes industriels. En tant que crise majeure, la pandémie de Covid-19 est une occasion unique de se saisir enfin de ces enjeux.
Les laboratoires pharmaceutiques ont joué, en lien direct avec des scientifiques académiques et des médecins, un rôle important dans l’invention, le développement et la fourniture de nouveaux médicaments. La diffusion au milieu du XXe siècle de médicaments comme les antibiotiques, les premiers psychotropes ou les premiers anti-cancéreux, comme l’implantation progressive de méthodes censées produire des savoirs objectifs sur les traitements (notamment les essais cliniques contrôlés randomisés), ont conduit à majoritairement considérer cette coopération entre industriels et acteurs du champ de la santé comme efficace et bénéfique.
À partir des années 1980, et dans un contexte de ralentissement des découvertes majeures, les tensions entre le capitalisme pharmaceutique et la santé publique ont été cependant de plus en plus dénoncées. Plusieurs dynamiques ont participé à cette problématisation croissante : la montée de « l’entreprenariat scientifique » (tout particulièrement dans les biotechnologies) et donc d’une fusion chez un certain nombre d’acteurs académiques des objectifs de développement des connaissances et de la recherche de profit ; la transformation au sein des industries pharmaceutiques des rapports de force internes entre services (marketing vs. recherche & développement) ; la financiarisation de ces industries conduisant à privilégier leurs actionnaires et les profits de court terme sur les investissements de long terme, notamment de recherche ; leur prise de contrôle accrue, pour maintenir des taux de rentabilité élevés malgré des découvertes plus rares, de l’ensemble de la chaîne du médicament (de la conduite des essais cliniques à la vie des cabinets médicaux).
Conflits d’intérêts et influence industrielle
Au sein du monde biomédical, une catégorie importée du monde politico-administratif – le conflit d’intérêts – a alors émergé comme une modalité essentielle de critique et de régulation (très partielle) de l’influence problématique des industriels [1]. Elle désigne dans son acception dominante des situations dans lesquelles les jugements ou les actions d’un professionnel concernant son intérêt premier (soigner un patient, produire des savoirs ou des expertises, prendre des décisions politiques) risquent d’être indument influencés par un intérêt qualifié de second (le plus souvent des gains ou des relations financières).
Le succès de cette catégorie s’est accompagné de la mise en place de procédures de plus en plus précises de déclaration d’intérêts censées assurer, par la transparence, une maîtrise des mécanismes d’influence. Bien que discutée comme mode de conceptualisation de l’influence, cette catégorie a ainsi permis d’objectiver les échanges financiers entre le monde industriel et les autres acteurs de la santé, mais aussi de démontrer statistiquement les conséquences de ces échanges sur les savoirs scientifiques et les pratiques des médecins.
En amont, les industriels contrôlent, grâce à leurs financements, le design et la conduite des essais dans un sens favorable aux médicaments promus, que ce soit au travers de la définition des critères choisis pour mesurer l’efficacité des produits, des populations sélectionnées pour participer aux essais ou des modalités d’enregistrement des évènements défavorables au cours des essais. La capacité des industriels de décider de la publication des résultats de ces essais (multiplication des publications sur les essais favorables, essais défavorables non-publiés) structure également l’état des savoirs. Enfin, la participation de scientifiques liés à ces industriels dans la transformation de ces savoirs en expertise et en recommandations pratiques à la fois accentue et légitime ce biais des sciences biomédicales.
Ces logiques d’influence doivent en outre être pensées dans toute leur dimension temporelle : les circulations entre secteur industriel et organismes publics sont très nombreuses, ce qui pose notamment des questions sur la communauté de vues et de carrières qui ainsi s’instaure. Le parcours de la nouvelle directrice de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) en est une illustration, elle qui avait intégré l’unité chargée des médicaments à la Commission européenne après sept années passées à la direction des affaires réglementaires de l’EFPIA, le puissant syndicat européen des industries pharmaceutiques. Le dernier commissaire de la Food and Drug Administration états-unienne a rejoint le géant Pfizer au lendemain de sa démission en 2018, année au cours de laquelle le directeur du département des vaccins de cette agence était embauché par un jeune laboratoire pour diriger sa stratégie sur ses produits et ses affaires réglementaires, l’entreprise Moderna.
En aval, les industriels parviennent à peser, par une myriade de liens entretenus depuis des décennies avec les médecins, sur leurs décisions cliniques et leurs prescriptions. L’omniprésence des industriels dans la vie quotidienne du monde médical, elle aussi permise par leurs capacités financières uniques (visites régulières dans les cabinets, financement de congrès ou des rencontres locales entre professionnels ou, pour les plus reconnus, travaux de consultance et speaking fees pour des discours à destination de leur pairs) contribue ainsi à façonner l’univers thérapeutique des médecins.
Comme l’a confirmé une récente méta-analyse, un médecin qui reçoit des versements de certains industriels aura ainsi statistiquement tendance non seulement à davantage prescrire les produits de ces entreprises, mais aussi à davantage prescrire, dans l’ensemble, des médicaments plus coûteux et des médicaments présentant un profil bénéfice-risque médiocre [2]. Notons en effet que les stratégies marketing seront d’autant plus « agressives » (que ce soit dans le contrôle de l’essai ou dans l’effort de promotion) que le médicament a un intérêt thérapeutique incertain, les molécules vraiment utiles n’en ayant pas autant besoin.
Cette double influence industrielle produit ainsi des risques iatrogènes et des dépenses collectives de santé injustifiées, mais elle amorce également des dynamiques de pharmaceuticalisation du social, les industriels étant perpétuellement à la recherche de nouveaux marchés. Avec le développement des réseaux sociaux, un nouvel espace dérégulé de l’influence s’est ouvert, rares étant les professionnels rendant publics leurs liens d’intérêts avec des thérapies dont ils vantent publiquement les bienfaits ou les promesses.
Alors que le scandale du Mediator avait visé avant tout les processus d’expertise et les pratiques des médecins, la pandémie de Covid-19 a rendu particulièrement visible une conséquence rampante de la présence des conflits d’intérêts : l’érosion de la crédibilité des savoirs scientifiques et de la légitimité des politiques sanitaires.
En effet, à la suite de la survenue à partir des années 2000 d’une série de scandales sur des médicaments largement prescrits (antidépresseurs, anti-inflammatoires, statines, traitement hormonal substitutif de la ménopause), la catégorie de conflit d’intérêts a été de plus en plus largement reprise, au-delà même des cercles professionnels, par des médias, des lanceurs d’alertes, des collectifs et des ONG, et même des acteurs politiques.
Cette mobilisation a permis de politiser ces enjeux d’influence industrielle et a conduit à l’adoption d’un certain nombre de politiques de transparence visant à en limiter les effets, par exemple des bases rendant publics les versements des industriels aux professionnels de santé comme Open Payments aux États-Unis ou Transparence-Santé en France. Cependant, aujourd’hui, la large diffusion dans la société de l’idée de conflit d’intérêts et la possibilité accrue d’en tracer l’existence heurtent de front l’omniprésence des industriels dans le monde médical.
Dans un contexte marqué par les discours de post-vérité trumpistes, dont on ne devrait pas oublier trop vite la portée radicale, l’étirement des controverses sur l’hydroxychloroquine ont offert au cours de l’année 2020 un exemple saisissant des conséquences sociales, politiques et sanitaires de cette question des conflits d’intérêts. Alors que le manque d’efficacité de cette molécule dans le traitement du Covid-19 apparaissait de manière de plus en plus évidente dans les essais menés mondialement sur la molécule, les convertis à l’intérêt de son usage ont de manière croissante expliqué ces résultats (comme les expertises et les décisions publiques) par les liens de leurs « opposants » avec les industriels, tout particulièrement avec l’entreprise Gilead, productrice du Remdesivir, constituée en molécule rivale. Notons qu’aux États-Unis, c’est au contraire l’engouement précoce du président Donald Trump pour l’hydroxychloroquine qui fut interprété par les médias comme des liens entretenus par des membres de son entourage avec des industries commercialisant le produit.
Plus largement, depuis le début de la pandémie, et que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France ou au Royaume-Uni, les différents comités mis en place pour piloter la réponse à la pandémie ou conseiller les gouvernements ont régulièrement été mis en cause du fait des liens de certains de leurs membres avec les industriels, que ce soit des travaux de consultance, la possession d’actions ou d’anciennes responsabilités dans des industries productrices de médicaments contre le Covid-19. Par exemple, le New York Times révéla que le chef de l’Operation Warp Speed, partenariat public-privé chargé aux États-Unis d’organiser et d’accélérer la réponse thérapeutique et vaccinale au Covid-19, était en forte situation de conflit d’intérêts : la valeur de ses actions Moderna venait de croître de 2,4 millions de dollars suite à l’annonce de la mise au point d’un premier vaccin contre le Covid-19.
Lorsque la négociation des contrats d’achat de vaccins par l’Union Européenne (UE) est devenue un sujet de débat, des observateurs ont pointé que l’un des négociateurs de l’Union était un ancien lobbyiste de l’industrie pharmaceutique. Une accusation contre laquelle la Commission européenne a répondu qu’il avait, comme les autres négociateurs, signé une déclaration attestant qu’il n’avait pas de conflit d’intérêts.
Certaines de ces accusations ont été relayées par les médias traditionnels mais elles ont, comme on peut l’imaginer, particulièrement été mobilisées dans les espaces fortement conflictuels que constituent les réseaux sociaux.
La pandémie de Covid-19 fait donc éclater au grand jour un risque évoqué depuis plusieurs décennies par des acteurs et observateurs critiques du monde médical : les effets délétères – en dehors même de leurs coûts sanitaires et économiques – des réponses faibles apportées aux enjeux de conflits d’intérêts sur la confiance dans la science et dans les décisions sanitaires. Contre un régime actuel reposant en priorité sur une extension des mécanismes de transparence, ces derniers réclament un renforcement ciblé des interdits, les différentes formes de coopération entre professionnels et industriels ne représentant pas la même valeur, ni les mêmes risques, pour la collectivité [3].
Innovation biomédicale et logiques financières
Si l’analyse des problèmes posés par les conflits d’intérêts permet de penser une partie des tensions entre santé publique et capitalisme pharmaceutique, elle n’épuise pas cette question. La dépendance tragique envers les produits contre le Covid-19 invite à interroger plus largement l’économie politique du secteur et, alors que le vocable guerrier fait depuis un an florès, la « guerre de position » qui se déploie sous nos yeux.
Depuis plusieurs mois, les noms des grands groupes pharmaceutiques ont envahi les médias comme les conversations quotidiennes des familles, associés à des produits synonymes de libération voire de salvation, et leurs représentants ont – fort logiquement – engagé une campagne de relation publique visant à redorer une image ternie mais aussi, plus fondamentalement, à éviter toute remise en cause de leur position hégémonique dans le secteur sanitaire. Les vaccins contre le Covid-19 constitueraient selon eux une preuve de la capacité des grands groupes industriels à agir dans l’intérêt général, grâce à leur capacité unique d’innovation, elle-même découlant de droits de propriété intellectuelle assurant une juste récompense à leurs efforts de recherche et à leur prise de risque.
Face aux ravages sanitaires et sociaux causés par la pandémie, des voix se sont à l’inverse efforcées de défendre l’idée selon laquelle les médicaments sont un bien commun, ont souligné la contribution centrale des États et des chercheurs académiques à leur invention et aux savoirs biomédicaux qu’ils incorporent, ainsi que l’existence de mécanismes légaux (adoptés en réponse à l’épidémie de VIH-sida) de suspension des droits de propriété intellectuelle attachés aux médicaments. Ils ont ainsi exhorté le pouvoir politique à défendre les intérêts des populations, qui ne se confondent pas avec ceux des acteurs industriels.
Les discours actuels des représentants des grands groupes pharmaceutiques appellent ainsi plusieurs remarques. Premièrement, le secteur pharmaceutique dégage, et ceci malgré les risques financiers indéniables que représente le développement de nouveaux médicaments, des taux de profit parmi les plus importants du monde industriel, certes souvent dépassés par ceux des banques et de l’industrie du tabac mais jugés équivalents à ceux du secteur – en pleine révolution novatrice – des logiciels et des services informatiques. Or, à la différence de ce dernier, et du fait de la nature spécifique du bien santé, ces profits sont dans leur plus grande partie, en Europe du moins, directement générés par des achats financés par les dépenses publiques.
Par ailleurs, les grands laboratoires pharmaceutiques sont très largement financiarisés et dépensent aujourd’hui davantage de ressources à récompenser leurs actionnaires (dividendes et importants rachats de leurs propres actions) qu’à investir dans la recherche et développement [4]. Des dépenses de R&D qui, comme le montre bien le cas du Covid-19, délaissent souvent la recherche fondamentale et les phases les plus « innovantes » de la recherche pharmaceutique.
Deuxièmement, les vaccins développés contre le Covid-19 sont à la fois d’une grande efficacité, d’une formidable utilité pour la santé publique et d’un coût individuel relativement limité, surtout s’il s’agit de les prendre une ou deux fois par an pendant quelques années. Ce triptyque n’est cependant pas représentatif des « innovations » pharmaceutiques qui, chaque année, s’efforcent de remplacer dans les pharmacies des produits plus anciens, qui ont la fâcheuse caractéristique de pouvoir être fabriqués par des industries du générique.
Le Remdesivir, médicament initialement développé contre la maladie d’Ebola et repositionné comme traitement du Covid-19 par Gilead, pourrait être malheureusement pris comme un symbole des dérives actuelles des marchés du médicament. Cette nouvelle indication a été en effet validée en urgence par les autorités de régulation américaines et européennes, malgré une efficacité – au mieux – extrêmement limitée, démontrée par des essais de faible valeur statistique, pour un coût de plus de 2000 euros pour une thérapie de cinq jours.
Les stratégies dominantes au sein des grands groupes pharmaceutiques consistent soit à rechercher de nouvelles indications pour des molécules qu’ils commercialisent déjà, soit à développer de nouvelles substances actives issues des biotechnologies – des molécules couramment rachetés à des start-ups – pour les vendre à des prix très élevés à des petits groupes patients, souvent en situation d’impasse thérapeutique.
Ce modèle de nichebuster [5] a tiré un large profit des législations adoptées aux États-Unis puis en Europe pour favoriser la commercialisation de médicaments dits « orphelins ». Certains de ces médicaments vendus à des prix prohibitifs constituent de véritables avancées médicales : on pense bien sûr à la commercialisation du Sovaldi dans le traitement de l’hépatite C. Mais pour d’autres, le bénéfice thérapeutique est beaucoup plus ambigu.
Ainsi, le domaine du cancer, qui a été central dans l’institutionnalisation des stratégies de nichebuster, est dans ce cadre particulièrement controversé. Les médicaments contre le cancer représentent aujourd’hui annuellement près de 100 milliards de dollars de vente dans le monde, avec des thérapies coûtant entre 30 et 70 000 euros par an et par patient en France, souvent plus de 100 000 dollars aux États-Unis, et pour des bénéfices thérapeutiques trop souvent faibles [6] : les 70 molécules enregistrées aux États-Unis contre les cancer solides (sein, colon etc.) entre 2002 et 2014 apportaient, selon les essais conduits par leurs propres promoteurs, une amélioration médiane de la survie de 2,1 mois.
Les questions d’accès aux traitements, depuis longtemps cruciales dans les pays du Sud, s’affirment dans les pays du Nord et, comme le montrent par exemple les positions du nouveau président des États-Unis Joe Biden, l’idée selon laquelle le rapport bénéfice-coût des nouveaux médicaments n’est plus supportable se généralise. Alors que la pandémie de Covid-19 a prouvé à quel point les besoins de personnel sont criants, que ce soit dans les hôpitaux ou les EHPAD, des régulations publiques plus exigeantes, tant sur les décisions d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des médicaments, de remboursement ou de fixation des prix, semblent de plus en plus indispensables afin d’assurer une plus juste allocation des ressources attribuées à la santé.
Troisièmement, l’innovation « récompensée » par la collectivité au travers des systèmes d’assurance maladie est loin d’être uniquement le fait des grands groupes pharmaceutiques qui réalisent la plus grande partie des ventes du secteur. Elle découle largement de la recherche académique et de plus petites entreprises de biotechnologie, souvent très liées à celle-ci. Le cas du Covid-19 est à cet égard remarquable.
Soulignons d’abord que le lancement rapide des différents programmes de recherche sur les vaccins contre le Covid-19 a été permis par le partage du séquençage génétique du virus par des chercheurs chinois dès le 10 janvier 2020, partage qui contraste avec les pratiques de secret, encouragées par les logiques industrielles, souvent en cours dans la recherche biomédicale. Du côté des vaccins les plus innovants, ceux reposant sur l’ARN messager, les deux premiers vaccins disponibles ont été développés par des entreprises de biotechnologie, Moderna et BioNTech (pour ce qui est pourtant appelé le « vaccin Pfizer »).
Il faut cependant rappeler que le vaccin dit « Moderna » a été longtemps un vaccin « NIH-Moderna ». Ce vaccin s’appuie en effet sur les recherches menées depuis plusieurs années au sein du NIH (National Institute of Health) américain sur la protéine Spike des coronavirus, qui ont conduit à l’élaboration au sein de cet organisme public d’une approche générique pour produire rapidement des vaccins contre ceux-ci. Dès publication du séquençage génétique du virus, le NIH s’est rapproché de la firme Moderna pour adapter cette approche à la protéine Spike spécifique du SARS-CoV-2 et pour produire le vaccin en résultant. C’est d’ailleurs le NIH qui conduira le premier essai clinique sur ce produit.
Le vaccin de l’entreprise BioNTech, comme celui de Moderna, s’appuie par ailleurs sur les découvertes réalisées par une chercheuse hongroise, Katalin Karikó (avec Drew Weissman), au sein de l’Université de Pennsylvanie. Celles-ci permettent notamment de limiter la réponse immunitaire des patients aux vaccins utilisant l’ARN messager. BioNTech n’a pas seulement racheté une licence sur un des brevets liés à ces découvertes, elle a recruté en 2013 cette chercheuse qui en est aujourd’hui la vice-présidente.
Pour donner un peu de profondeur historique à ces rapides remarques sur l’appropriation capitalistique de l’innovation biomédicale, on rappellera que le concept même d’ARN messager est lui né des travaux de Jacques Monod et François Jacob et de leurs équipes dans les années 1960.
Du côté du vaccin classique « AstraZeneca », il a en fait été, comme on le sait, mis au point par une équipe dirigée par le Professeur Sarah Gilbert au sein du Jenner Institute de l’université d’Oxford. Si elle a été capable d’élaborer rapidement un vaccin contre le Covid-19, c’est qu’elle avait inventé et testé un vaccin ayant le même principe d’action qui visait un autre coronavirus (le MERS-CoV). Ces recherches découlaient elles-mêmes d’un programme de recherche vaccinale portant sur la malaria, initié par l’actuel directeur de cet institut, le professeur Adrian Hill.
Ainsi, la mise au point des vaccins contre le Covid-19 illustre la performance d’une recherche académique de long terme orientée par des objectifs de santé publique, et notamment l’importance cruciale des recherches fondamentales, bien plus que les capacités novatrices des « big pharma ». Le développement économique de ces grands groupes industriels s’appuie aujourd’hui crucialement sur des rentes générées par l’achat de droits de propriété intellectuelle et sur leur maitrise unique, pour le meilleur et pour le pire, de la chaîne du médicament.
La place déterminante de la recherche publique dans les vaccins contre le Covid-19 pourrait ne pas être sans conséquence sur la mise en pratique des discours présentant le médicament comme un bien commun : de nombreux acteurs politiques et sanitaires demandent ainsi aujourd’hui aux États de s’appuyer sur les brevets issus de la recherche publique (spécifiquement ceux déposés sur la protéine Spike des coronavirus et son utilisation) pour imposer aux industriels des conditions de production et de commercialisation permettant un accès de toutes et tous aux vaccins contre le Covid-19, notamment dans les pays les plus pauvres, voire pour suspendre les droits de propriété intellectuelle protégeant ces produits.
L’historien allemand Reinhart Koselleck a rappelé qu’avant que ne se répande l’usage métaphorique du concept médical de crise, pensée comme une acmé permettant de lire des symptômes, ce terme a relevé dans le monde grec du domaine du droit. Il renvoyait alors, notamment chez Aristote, aux jugements justes au travers desquels peuvent se tisser les liens entre les individus et leur communauté.
Il reste un mince espoir que la crise du Covid-19 permette de repenser et de transformer dans un esprit de justice les liens entre capitalisme pharmaceutique et santé publique.
