Sahel, l’éternel recommencement
Aujourd’hui, les militaires français officiellement basés au Niger sont plus nombreux que ceux qui occupaient ce territoire pendant la période coloniale.
Ces militaires ne construisent plus des « postes », comme une centaine d’années plus tôt, mais ouvrent ou ferment des bases ; ils ne font plus de « tournées de police » ou de « pacification », mais dirigent des opérations ou des raids ; ils n’affrontent plus des « indigènes », mais des terroristes ; par contre, ils meurent toujours au combat, possèdent des équipements techniquement supérieurs et continuent d’agir au nom de ce qu’ils considèrent comme « un impératif de respect de la dignité de l’homme et des valeurs que porte la France ». La rhétorique de la mission civilisatrice est ainsi réinterprétée.
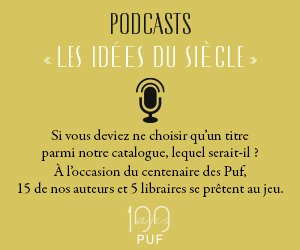
Les représentations et les souvenirs de ce que les militaires français appellent la conquête du Sahara façonnent encore profondément la mythologie de l’armée française. Les officiers et les sous-officiers des opérations Serval et Barkhane lisent les mémoires de leurs prédécesseurs, sont formés dans les mêmes écoles, sont organisés dans les mêmes unités et idéalisent la vie aventureuse et le sens du sacrifice de ceux qui les ont précédés.
Certains d’entre eux sont issus de dynasties militaires et ont dans leurs arbres généalogiques un grand-père ou un grand-oncle qui ont servi ou qui sont morts sur les terrains coloniaux. Le corps des officiers est encore aujourd’hui marqué par une forte endogamie et les plus hautes fonctions sont dominées par les héritiers d’une bourgeoisie catholique attachés aux valeurs traditionnelles et à la hiérarchie [1]. Comme pendant la période coloniale, les opérations extérieures, notamment les missions au Sahel, accélèrent l’avancement et les carrières.
L’armée en tant qu’institution contrôle largement les récits sur le Sahara et le Sahel dans la presse française grand public. Peu de journalistes français ne remettent en question l’idée développée par l’État-major selon laquelle
