Islamo-gauchisme, histoire d’un glissement sémantique
Le prolétariat et le prophète, publié en 1994 par Chris Harman, leadeur du SWP (Socialist Workers Party [1], mouvement trotskiste au Royaume-Uni), est souvent considéré par les pourfendeur·se·s de l’islamo-gauchisme comme la preuve manifeste de la « complaisance » d’une partie de la gauche radicale avec le projet islamiste [2].
Dans son livre Un racisme imaginaire (Grasset, 2017), Pascal Bruckner considère ainsi qu’Harman « prône une alliance entre militants de gauche et associations musulmanes radicales qu’on aurait tort, selon lui, de qualifier de rétrogrades ». Or, si on prend le temps de lire ce texte d’environ quatre-vingts pages, on décèle une position beaucoup plus nuancée, une accumulation d’affirmations simplistes au sujet de la nature intrinsèque de l’islam et une analyse assez fine de la multiplicité des positionnements des mouvements issus de l’islam politique en Iran, au Soudan ou en Égypte.
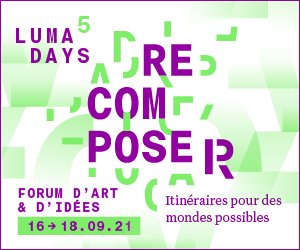
Harman considère que la gauche n’a pas su réagir à l’émergence de l’islam politique. Selon lui, deux positions auraient alors vu le jour à gauche. La première a perçu dans ces mouvements une évolution contemporaine du fascisme alors que la deuxième les a définis comme une réaction progressiste et anti-impérialiste de la part des dominé·e·s. Harman renvoie dos à dos ces deux analyses : la première a conduit des mouvements de gauche à soutenir des régimes autoritaires ; la seconde a donné lieu à une coupable absence de critiques sur le plan idéologique entre la gauche et les forces de l’islam politique.
Harman montre ensuite que les mouvements islamistes ont souvent divergé sur les stratégies politiques à adopter (notamment sur l’usage de la violence politique) et qu’ils ont pu, selon le contexte, soit canaliser le mécontentement populaire et en tirer profit, soit se satisfaire d’une attitude complaisante avec les régimes autoritaires en n’obtenant que des transformations à la marge (en particulier par rapport à la structuration des classes sociales).
Selon
