La fabrique sociale des radicalisations juvéniles : hypothèse et perspectives
Si le phénomène de radicalisation qualifié d’islamique est devenu l’une des préoccupations majeures de l’activité médiatique, notamment lors d’épisodes d’attentats, nous ne savons pas grand-chose a priori des terroristes, hormis leur jeunesse et leur « intérêt » controversé pour l’islam. Nous nous sommes rendu compte que les parcours des jeunes nommés « djihadistes » par les médias sont nettement plus complexes et hétérogènes.
Certains politologues comme Gilles Kepel ou Bernard Rougier font des liens de causalités systématiques entre jeunes des quartiers, islamisme et terrorisme. Les parcours des terroristes identifiés comme tels par la justice montrent davantage des rapports distants entre les radicalisés et la pratique religieuse des musulmans du quotidien.
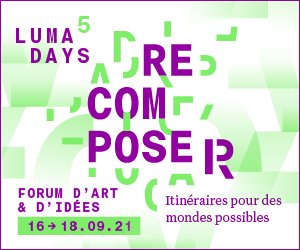
De plus, il est important de préciser d’emblée deux faits essentiels : 1/ tous les musulmans et les jeunes dits « de cité » ne sont pas terroristes tant s’en faut : quatre jeunes au total sur trois cent cinquante-six observés dans deux quartiers populaires de deux villes d’Ile-de-France en 2017 se sont rendus dans les pays du Maschrek et du Cham ; 2/ tous les « radicalisés » ne sont pas musulmans d’origine et ne proviennent pas majoritairement des quartiers populaires urbains.
Ainsi, la thèse défendue par certains chercheurs au sujet d’une sorte de contextualisation des processus de radicalisation dans l’histoire sociale des quartiers populaires urbains comme résultants de la dégradation des conditions de vie des habitants des cités, depuis la marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983 et les révoltes urbaines en 2005, n’est donc pas tout à fait convaincante. En effet, certains individus identifiés comme radicalisés sont parfois issus des classes moyennes et ne sont pas de familles musulmanes.
C’est pourquoi nous avons mobilisé la notion d’exil pour décrire les formes multiples d’exclusions sociales rencontrées par les jeunes des « quartiers » et des milieux populaires, mais aussi pour appréhe
