Le marché des footballeurs : une « bulle » qui fait pschitt…
L’économie du football professionnel est un sujet compliqué souvent analysé de manière trop simple. La tendance est fréquente à lui appliquer, dans le meilleur des cas, des concepts généraux qui ne sont pas adéquats, et dans le pire, des concepts idéologiques forcément biaisés. Par exemple, les clubs de football ne sont pas des entreprises comme les autres, qui maximisent leur profit, et les supporters pas des « clients » comme les autres, qui ne cherchent simplement qu’à augmenter leur consommation. Mais c’est un autre concept très souvent invoqué dans les médias à propos de l’économie du football que nous voudrions examiner ici : la soi-disant « bulle » financière qui, par hypothèse, devrait finir par exploser.
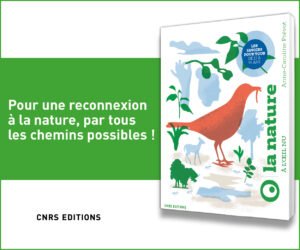
Certains voient dans la crise qui secoue actuellement le football, liée surtout aux conséquences de l’épidémie du Covid-19, le « pschiit qui annonce le krach ». Sans aller jusqu’à cette extrémité, la crise sanitaire ne pourrait-elle pas être simplement un « stress test » pour la stabilité financière de l’économie du football, révélant certaines faiblesses potentielles du modèle ? Le concept de « bulle » en économie signifie, en effet, tout autre chose.
Qu’est-ce qu’une bulle ?
Si, pour le profane en finance, invoquer une « bulle » traduit simplement l’antienne qu’« il y a trop d’argent dans le football » (les sommes sont pourtant minimes par rapport à d’autres secteurs de l’économie), que « les footballeurs sont trop payés » (les joueurs certes « captent la rente » mais seulement quelques-uns gagnent des millions) et que la valeur de leur transfert est « absurde » (seules 10 % des mutations dans le monde sont en fait payantes), pour les professionnels de la discipline, l’existence d’une bulle correspond à une situation bien définie.
Les économistes s’accordent à dire qu’il y a une bulle spéculative (ou financière) sur un marché (immobilier, financier, etc.) si les actifs se négocient à des prix qui dépassent largement et durablement leur « valeur
