COP26 : pourquoi une nouvelle déception ?
Il ne faut pas exiger des COP ce qu’elles ne peuvent produire. La presse internationale, jamais avare de superlatif, a eu tôt fait de proclamer qu’il s’agissait du « sommet de la dernière chance ». Une grandiloquence contreproductive quand la principale conclusion du Pacte de Glasgow est d’avoir choisi – encore une fois, hélas – de reporter à l’an prochain l’obtention d’engagements plus importants.
Les COP sont des instances de négociations internationales destinées à produire un consensus le plus large possible. À ce titre, elles sont assujetties au double règne de la langue diplomatique et la complexité technocratique. Un tel cocktail ne peut laisser qu’un goût bien fade devant l’importance historique de l’enjeu et l’énergie des mobilisations pour le climat.
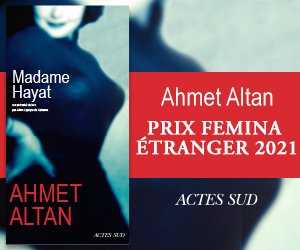
Ceci explique en particulier pourquoi l’inclusion des termes « énergies fossiles » dans le Pacte de Glasgow, une première, est considérée comme une avancée majeure par les négociateurs. Cet ajout implique que les principaux producteurs pétroliers, OPEP et Russie en tête, ont enfin accepté de désigner l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz naturel fossiles comme principaux responsables du dérèglement climatique. Mais il faut admettre qu’en dehors de ce contexte, il paraît surréaliste d’avoir dû attendre vingt-sept ans de négociations pour reconnaître l’évidence.
Plus prosaïquement, les COP sont également le barnum médiatique que beaucoup décrient. En des temps pas si reculés où la crise climatique était loin encore d’occuper le devant de la scène, elles permettaient de jeter un coup de projecteur précieux sur des enjeux trop ignorés. Ce rôle est moins essentiel aujourd’hui, mais les COP restent un forum important de rencontre et de coordination des acteurs étatiques et non-étatiques, et de mobilisation remarquable pour les mouvements de la société civile engagés dans la lutte pour le climat.
Les défenseurs du processus ont raison de souligner que le processus des COP est l’un des mécanismes de
