Les multiples défis de nos planétarités
La notion de « planétarité » a le double avantage de « faire image » dans notre tête et de nous ouvrir l’esprit à une pluralité de visions du monde, du globe, de la Terre, de Gaïa. Quel que soit le terme utilisé pour dénommer notre planète, tenter d’en figurer la forme et l’à-venir, avec ses animaux et ses éléments physico-chimiques, ses êtres et ses agents, ses plantes et ses phénomènes cosmologiques nous incite à la pensée et, peut-être, à l’action. Face aux incendies, aux inondations et aux pandémies qui nous attendent sans aucun doute au coin de la rue comme de la forêt, nos devenirs planétaires dépendent des façons dont nous nous serons imprégnés, orientés par nos rêves et nos cauchemars, nos peurs et nos espoirs, nos sciences et ces mythologies que nous ne cessons de réinventer…
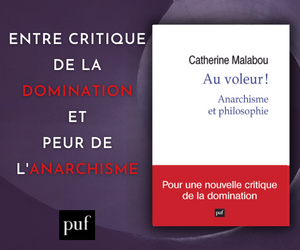
Monde, globe, géopolitique, Terre, Gaïa
Commençons par poser et éclairer les différences de vocabulaire. Le monde est ce qui fait sens du point de vue autocentré d’une certaine culture : les individus et les collectifs humains se construisent des mondes pluriels à l’intérieur d’un même environnement, selon les systèmes symboliques qu’ils ont développés pour s’y orienter. Le défi du multiculturalisme tient à reconnaître qu’entre voisin·es au sein d’une même ville, nous vivons souvent dans des mondes différents.
Ce que nos usages actuels désignent par le terme de globe reste centré sur les valeurs humaines, et plus particulièrement sur des modes de valorisations économiques et financières qui s’appliquent maintenant à travers les cultures et tous les continents. Comme le dit Dipesh Chakrabarty, « l’histoire de la globalisation place les humains en son centre et raconte comment les humains ont forgé historiquement un sens humain du globe[1] ». La globalisation poursuit (et parfois renverse) une expansion coloniale qui se mène à coup de conquêtes financières et de dépendances logistiques.
Ce qu’il est convenu d’appeler la géopolitique se propose depuis plus d’un siècle de traduir
