Z. ou le spectre du passé
L’État français s’est toujours caractérisé par son incapacité à faire face à son passé. Depuis les lendemains des guerre napoléoniennes, jusqu’aux dernières décennies de la décolonisation, la lenteur avec laquelle l’institution étatique fait retour sur les périodes de troubles, d’incertitudes ou de conflictualité est devenue une spécificité française. Le silence de l’histoire officielle sur les compromissions avec le fascisme ou durant les années d’exploitation de pays dominés, participe de la spécialité nationale.
Nombre de générations ont été élevées dans l’idée d’une France éternelle, exempte de tout excès et pays des droits de l’homme. Les valeurs universelles, dont la nation se réclame, amplement répandues à travers le monde, auraient érigé le pays en modèle. Longtemps cette représentation permit aux autorités de faire l’impasse sur plusieurs périodes de forfaitures : celle de l’antisémitisme massif des années 1930, par exemple.
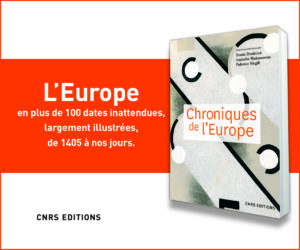
Hérité de l’affaire Dreyfus – dont le récit fut écrit au seul profit de la République, au mépris des dreyfusards des premiers jours –, la mise à l’écart des juifs se prolongea naturellement par la collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. L’après-guerre fut suivie d’un long silence sur les exactions de tous ordres qui furent pratiquées par les représentants français dans le long temps de la colonisation ; le tout accompagné du rejet massif des travailleurs étrangers à l’intérieur de nos frontières.
La nostalgie d’une France irréelle ou mythique fait office de refuge à nombre de nos contemporains qui craignent de perdre leurs repères, leurs privilèges ou leur suprématie ; le détour vers un passé improbable, fréquent dans les périodes d’incertitudes, est aujourd’hui manifeste d’autant que ces dernières décennies furent mises à nu les multiples formes de domination à l’encontre des catégories que le grand historien anglais E.P. Thomson qualifiait de subalternes : les pauvres, les femmes et bien sûr les anciens colo
