L’OTAN, Poutine et la guerre en Ukraine
Le président russe Vladimir Poutine, après un renforcement soutenu de ses forces – le total atteignant 120 000 soldats et membres de la garde nationale –, a décidé le 24 février de lancer une invasion à grande échelle en Ukraine. Cette décision a ravivé un débat très vif aux États-Unis. D’un côté, il y a le camp composé principalement, mais pas exclusivement, de personnes appartenant à l’école de pensée réaliste. Ce camp insiste sur le fait que la décision de Poutine ne peut être comprise qu’en tenant compte des frictions que l’expansion de l’OTAN vers l’est a créées entre la Russie et les États-Unis. L’autre camp, composé principalement de néoconservateurs et d’internationalistes progressistes, rétorque que les protestations de Poutine contre l’élargissement de l’OTAN sont fallacieuses, et affirme que l’animosité de Poutine à l’égard de la démocratie – en particulier la crainte que le succès de celle-ci en Ukraine ne déteigne sur la Russie et ne fasse tomber l’État qu’il a construit depuis 2000 – est la seule raison de la guerre.
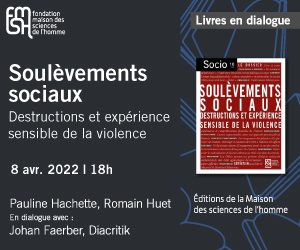
Les deux parties ont succombé à « l’erreur du facteur unique ». Étant donné la complexité de l’histoire et de la politique, pourquoi devrions-nous supposer que Poutine n’a qu’un seul objectif, qu’une seule appréhension ? Il s’en suit que leurs échanges ont été peu concluants, produisant plus de chaleur que de lumière. On a parfois assisté à des représentations simplistes du réalisme dans les colonnes des quotidiens et des magazines et, pire encore, à de vilesattaques ad hominem. Il y a eu peu de débats pertinents. Les médias sociaux ont donné lieu à beaucoup de bruit et de fureur, aussi fructueux que les tentatives d’un chien qui court en rond pour attraper sa queue, en beaucoup moins drôle.
L’opposition à la guerre de Poutine contre l’Ukraine ne doit pas nous empêcher de chercher à comprendre les circonstances qui y ont conduit. Il est important d’insister sur ce point, car la guerre a suscité de vives émotions, et les analyses
