Comprendre l’ancrage périurbain d’un vote FN/RN
Cela fait plus d’une vingtaine d’années maintenant que les médias scrutent les résultats électoraux engendrés par le Front national puis par le Rassemblement national à distance des grandes métropoles. Le portrait qu’ils en dressent épisodiquement reste celui d’une France délaissée, qui serait marquée par les difficultés économiques, et où les classes populaires, en proie au déclassement, n’auraient d’autre choix que de se tourner vers un vote protestataire.
La survenue du mouvement des Gilets jaunes, à l’automne 2017, est venue renforcer cette image des classes populaires vivant hors des grandes villes, et qui, du fait du déclin des organisations classiques d’encadrement que sont les partis et les syndicats dans le monde du travail, se mobilisent de façon imprévisible face à des conditions de vie de plus en plus contraintes.
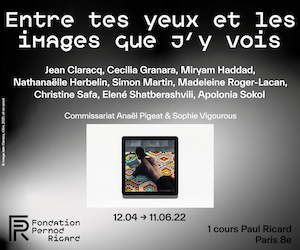
Force est pourtant de constater que la vision qui se dégage ainsi d’une « France des ronds-points » reste souvent schématique, et en tous les cas, très simplificatrice. Des travaux récemment publiés mettent en effet en lumière, enquêtes localisées à l’appui, la diversité interne qui caractérise les classes populaires aujourd’hui : des jeunes ruraux vivant dans des bassins en fort déclin[1], en proie à une concurrence exacerbée pour l’accès à l’emploi, aux ménages stables qui, sans toujours être préservés, s’attachent à « être comme tout le monde » et sont porteurs d’aspiration à la promotion sociale[2], les dynamiques sociales qui travaillent les classes populaires sont diversifiées. Pluriels, les groupes sociaux dominés ont des pratiques électorales, de l’abstention plus ou moins intermittente au vote à gauche, à droite ou à l’extrême droite, qui se caractérisent en premier lieu par une forte dispersion[3].
Comme l’a montré le collectif Focale, à partir d’un questionnaire administré à la sortie des urnes dans deux communes, les suffrages des classes populaires, lorsqu’ils sont exprimés, se trouvent polarisés en 2017 entre le candidat
