La tragédie industrielle
La Covid-19 et ses confinements ont dévoilé sur la scène médiatique la base industrielle de notre société. Les ruptures d’approvisionnements et les pénuries successives ont montré la matérialité industrielle cachée derrière l’immatérialité virtuelle, fluide et numérique des nombreux services sur lesquels reposent de nos quotidiens urbains.
Baignant dans ce même quotidien métropolisé, les journalistes de médias produisant des informations à obsolescence accélérée, terrifiés de ce surgissement, ont remis en selle les thèmes de l’indépendance industrielle, de la réindustrialisation, du redressement industriel, la renaissance industrielle ou enfin la souveraineté industrielle. Des journalistes relayés bientôt par presque tous les candidats à la présidentielle de 2022.
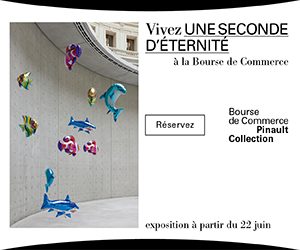
Toutes ces qualifications du renouveau ont la même signification implicite, celle de retrouver une puissance productive nationale dont les corollaires statistiques formels sont les gains de productivités, la croissance économique et l’emploi industriel.
Ils ne se sont pourtant pas trompés d’objet, car l’industrie est bien un phénomène socio-économique au cœur du rapport de production propre au capitalisme, son évolution est ainsi un enjeu politique essentiel.
Pourtant, il y a encore quelques années, on a tenté de nous faire croire que le « développement économique » des pays dits avancés se mesurait à la petite taille de son secteur industriel. Les plus avancés auraient ainsi réussi à dépasser l’industrie et sa matérialité lourde, bruyante et polluante avec ses ouvriers syndiqués.
À l’orée du millénaire, des prophètes du progrès –un progrès identifié à des déversements successifs d’un besoin à un autre (biens puis services donc) – ont imaginé « les entreprises sans usines[1] », l’avancée d’une société se mesurant alors à la faiblesse de son secteur industriel. L’histoire sociale et politique des deux dernières décennies montre bien une baisse progressive de la production dite « industrielle »[2]
