Les milliardaires et le karting
Quel est le point commun entre des activités organisées de manière exceptionnelles pour des personnes détenues en prison et des jets privés de milliardaires qui opèrent des déplacements réguliers en France comme à l’étranger ?
A première vue, pas grand-chose[1]. Premièrement, il y a, d’un côté, des activités situées dans le temps et dans l’espace : celle du Centre pénitentiaire de Fresnes, le 27 juillet 2022, dont les images sont diffusées quelques semaines plus tard[2]. L’épreuve de karting a duré 10 minutes[3]. Ces images font, par exemple, l’ouverture du journal télévisé de 20h de France 2, le 20 août. De l’autre, une aptitude à se jouer du temps et de l’espace : d’une part, parce que les jets privés compriment l’espace pour gagner du temps dans des déplacements qui, autrement, seraient plus coûteux.
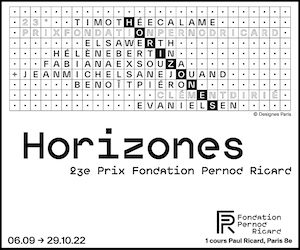
C’est une autre géographie qui apparaît dans le suivi assuré par les comptes Twitter[4] : celle où les moyens de l’argent écrasent la distance, soit pour se déplacer plus vite sur de courtes distances[5], soit pour rendre possible en une poignée d’heures, ou sur une journée, des trajets qui nécessiteraient une durée beaucoup plus longue sans le recours aux jets privés, par exemple pour rejoindre des îles (comme l’avion de François-Henri Pinault le 9 juillet de Friedman aux Etats-Unis à Hawaï).
D’un côté, la souffrance physique et psychique, l’ennui de la prison et les corps entravés, de l’autre, les vies évènementielles et la mobilité comme horizon moral qui rappellent la nécessité de faire atterrir les réflexions sur « l’accélération » dans des contextes particuliers. La vitesse plus grande de certains flux n’est pas également distribuée. Comme le rappelle le philosophe Christophe Bouton, le sentiment d’accélération technologique et politique, devenu accélération tout court, n’est pas un phénomène global et implacable dont rien ne réchapperait[6]. Face au temps accéléré des espaces sans frontières, des limites politiques, législatives, administratives, fin
