Leçons du bord du gouffre nucléaire, de Cuba à Kiev
«Est-ce que vous réalisez que si je fais une erreur dans cette crise, deux cents millions de personnes vont se faire tuer ? »[1] C’est ainsi que le Président américain John Kennedy a décrit sa situation à son porte-parole Pierre Salinger, durant la crise d’octobre 1962. Soixante ans plus tard, face aux menaces nucléaires russes dont l’ombre couvre l’invasion de l’Ukraine, son lointain successeur Joe Biden annonce que « nous n’avons pas fait face à l’hypothèse d’une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains. »[2] Il nuance dès le lendemain son propos sur l’apocalypse en insistant sur l’incertitude relative à l’issue de l’escalade. Que faire de ces prises de parole ?
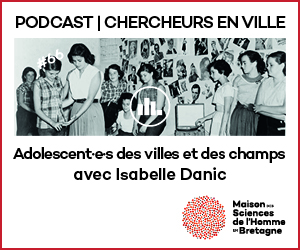
Alors que les dirigeants de l’OTAN s’engagent également dans une rhétorique nucléaire, que les arsenaux existants demeurent très au-delà de ce qui serait suffisant pour mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissons et que nous ne disposons toujours pas de protection contre des frappes nucléaires délibérées, accidentelles ou non-autorisées, il est essentiel d’apprendre des crises nucléaires passées. Cette analyse fait le point sur les résultats de soixante ans de recherche sur la crise de Cuba, la crise nucléaire la plus étudiée, puis se penche plus précisément sur le processus d’apprentissage et les obstacles auxquels il fait face, avant d’en tirer cinq leçons pour la situation en Ukraine, à la lumière des résultats de la recherche indépendante.[3]
Apprendre des crises nucléaires passées : le cas de Cuba
En octobre 1962, des avions espions américains détectent la présence de sites de missiles soviétiques à Cuba.[4] S’ensuit une crise internationale comprenant une mise en quarantaine de l’île par la marine américaine, qui s’apparente à un blocus, c’est-à-dire un acte de guerre, et la considération de l’emploi de la force voire de l’invasion de Cuba par le comité exécutif issu du Conseil de Sécurité Nationale américain chargé de conseiller le jeune Président démocrate
