Penser la scénographie dans un monde fini
Si l’on considère l’ensemble du cycle de la vie matérielle d’un spectacle, la grande majorité des scénographies a aujourd’hui une fin de vie encore bien peu poétique. À usage unique, bennés comme déchet industriel banal ou non valorisés après l’exploitation, les décors sont encore peu ou mal stockés et rarement réemployés. On peut espérer que ces usages changent grâce à la prise de conscience collective du gâchis que cela constitue. Il reste vrai qu’il est encore difficile de mettre en place une circularité des décors et des matières qui permette d’en limiter la mise au rebut. Au manque de temps et d’outils, s’ajoutent de vraies difficultés juridiques et de sécurité, qui imposent une actualisation des normes. Ressourceries de matières, expérimentations dans les ateliers de construction, réseaux de professionnel·les de l’écoscénographie… nombreuses sont aujourd’hui les initiatives cherchant à mettre en œuvre une transformation des modes de production.
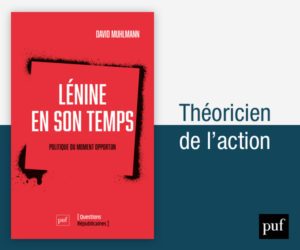
L’attention écologique du secteur s’exprime aussi par des modes de création portés par les scénographes et les metteur·es en scène : expérimentation directe (principe de scénographie de plateau), utilisation de matières non normées, attention au vivant non-humain et au non vivant. Ces pratiques de travail et de collaboration supposent un ralentissement du rythme de production et témoignent d’une forme d’économie de moyens salutaire. De nombreuses créatrices et de nombreux créateurs ont déjà des pratiques attentives à la matière scénographique et à son devenir, et accompagnent le renouvellement de notre regard de spectateur·ice à l’heure de l’augmentation de notre conscience écologique.
La présence, visible ou invisible, de l’écologie dans la scénographie de théâtre est un sujet passionnant car il noue des enjeux techniques, esthétiques et politiques autour de l’ensemble des acteur·ices d’un spectacle, jusqu’au/à la spectateur·ice. Pour interroger la multiplicité de ces enjeux, nous entreprenons depuis un an d’
