Les mondes de l’art alternatifs du fanzine
Une nouvelle génération d’artistes paraît parfois plus séduite par l’idée de produire et de diffuser elle-même son travail plutôt que par le circuit habituel des galeries et institutions traditionnelles. Parmi les très nombreux médiums à sa disposition, les formats imprimés se sont imposés comme une évidence, depuis les techniques d’estampes traditionnelles, jusqu’aux livres d’artistes qui trouvaient leur origine dans l’art conceptuel, la poésie concrète et le mouvement Fluxus. Mais le format le plus populaire aujourd’hui est le « zine » ou « fanzine », qui se situe plutôt dans la filiation des publications punks et underground que dans la grande tradition bibliophilique.
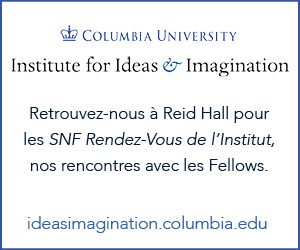
Ce format à faire soi-même, dont les codes sont tellement souples qu’on peine parfois à le catégoriser, offre une très grande liberté tant sur le fond que dans les formes choisies. Trouvant sa source dans l’esprit Do It Yourself (DIY) initié par les artistes punks à la fin des années 1970, le fanzine a suivi une évolution surprenante et il est même parvenu à survivre à l’apparition du web, jusqu’à devenir ces dernières décennies un médium de référence.
Qu’est qu’un fanzine ?
Les premières publications amateures à proprement parler apparaissent à la fin du XIXe siècle au sein de cercles littéraires afin de publier poésies et nouvelles. Par la suite, les publications amateures de la première partie du XXe siècle, imprimées à l’aide de techniques aujourd’hui disparues, comme le duplicateur à alcool ou le miméographe, traitent principalement de littérature et plus précisément de science-fiction. Parallèlement, les avant-gardes du début du XXe siècle publient leurs propres journaux dans un esprit dadaïste.
Alors qu’on considère habituellement The Comet, publié en mai 1930 par le Science Correspondence Club comme le tout premier fanzine du genre[1], ce n’est qu’à partir de 1940 que le terme de « fanzine » (contraction de fanatic et magazine) est adopté pour désigner ce type de publication amate
