Pourquoi est-il si difficile de réformer les retraites en France ?
Selon le rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites paru le 15 septembre 2022, la part des dépenses de retraite dans le PIB resterait globalement stable voire diminuerait entre 2021 et 2070. De nombreux commentateurs se sont cependant focalisés sur les projections de déficits à moyen terme et ont appelé à une « réforme des retraites », plus ou moins urgente selon le regard porté sur le diagnostic. Et chacun d’agiter la perspective d’une « fronde sociale » vis-à-vis d’une réforme nécessairement envisagée comme réductrice des droits à retraite dans le futur.
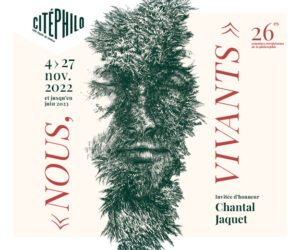
Il est vrai qu’il semble plus difficile de réformer les retraites en France, lorsque l’on compare l’ampleur et la portée de certaines réformes adoptées au cours des dernières décennies dans d’autres pays européens, tels que l’Italie, la Suède et l’Allemagne. Et le projet de réforme des retraites dessiné dans le programme électoral du candidat Emmanuel Macron en mai 2017 – et dont l’adoption a été finalement suspendue dans le processus législatif en mars 2020 – apporte de l’eau au moulin de qui pense que toute réforme est impossible.
Or la France a connu pas moins de cinq réformes depuis 1993, même si certaines ont été adoptées avec un consensus minimal. L’échec de la dernière réforme (au-delà de sa suspension lors du confinement du printemps 2020 pour cause de pandémie de Covid-19) trouve son origine dans le hiatus entre son design inspiré par de nombreux travaux universitaires ainsi que par l’expérience suédoise de réforme dans les années 1990, et la méthode pratique envisagée pour la mettre en œuvre.
De systémique et cohérent, le projet s’est transformé en un empilage de dispositifs techniques, souvent incompréhensibles, au cœur desquels l’âge de départ à la retraite cristallisait l’attention. L’ambition politique initiale était étouffée dans l’œuf par une poignée de techniciens de la retraite pour lesquels l’équilibre financier du système est sa seule raison d’être.
Cet échec laisse désorma
