De l’autoritarisme russe à la guerre en Ukraine
La guerre d’agression russe contre l’Ukraine a profondément choqué de nombreux spécialistes de l’espace post-soviétique, dont moi. Notre consternation va au-delà des considérations générales de l’humanisme (la violence, la destruction, la douleur totalement inutiles sont choquantes en soi) ou des raisons personnelles – si tous les chercheurs qui se consacrent à l’étude de la région n’ont pas forcément des proches dans la région (ce qui n’est pourtant pas rare), ils accumulent les relations avec des collègues locaux et avec des enquêtés qui deviennent progressivement amis ou au moins peuvent provoquer de la sympathie. Il y a aussi une raison professionnelle à un tel choc, pour moi comme pour de nombreux collègues : politiste et sociologue qui observe la politique dans l’espace post-soviétique pendant des années, qui a étudié les sociétés et les systèmes politiques russe et biélorusse, j’ai dû constater que cette guerre est arrivée de manière inattendue pour moi.
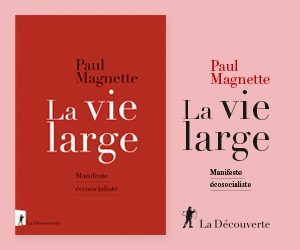
Comme de très nombreux collègues, j’étais certain que les manœuvres et déclarations qui ont précédé l’invasion russe étaient un instrument dans le conflit symbolique avec l’Occident, dont l’objectif était de déstabiliser la situation politique en Ukraine et d’essayer de revoir le système de relations internationales en Europe de l’est. Nous nous étions habitués aux menaces et aux gesticulations des dirigeants russes, et la probabilité d’une vraie guerre totale semblait faible, rationnellement parlant, y compris à cause de l’importance des coûts qui y seraient associés. Alors pourquoi cette guerre a-t-elle été commencée ?
On ne peut pas se satisfaire des raisons proclamées par les autorités russes. Il n’y avait pas de menace militaire immédiate pour la Russie de la part de l’Ukraine ou des États occidentaux (« l’Occident collectif » entrainé par les « Anglo-saxons », comme le désigne la propagande russe). Les justifications par le combat contre le nazisme en Ukraine ou la réponse au soi-disant génoci
