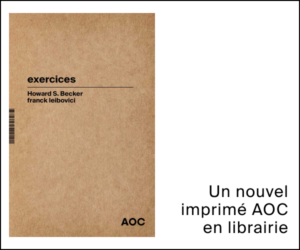Israël, à droite toute
Les résultats des élections législatives, le 1er novembre dernier, ont plongé la moitié des électeurs d’Israël dans l’effroi. Après être parvenu à constituer une majorité de blocage lors des premiers tours d’élection successifs en 2019 et 2020, puis à former un gouvernement de coalition après le quatrième tour en mai 2021, voilà que le front anti-Netanyahou engagé malgré lui dans un cinquième combat, a perdu la bataille au point de douter s’il gagnera la guerre pour la paix et pour la démocratie.
Les faits sont accablants et la défaite incontournable : d’abord, Benjamin Netanyahou et ses alliés ont obtenu une majorité absolue de sièges à la Knesset avec 64 députés sur 120. Ensuite, les trois formations de l’extrême-droite nationaliste et théocratique regroupées dans un parti nommé « Sionisme religieux » ont enregistré la percée la plus spectaculaire dans ce scrutin, passant de 7 à 14 sièges, soit de 250 000 à un demi-million d’électeurs. Last but not least, comme si ces deux résultats ne suffisaient pas, voilà que la gauche sioniste a perdu l’un de ses deux piliers avec l’élimination du parti Meretz qui assumait la tâche de dénoncer l’occupation israélienne sans relâche et sans équivoque, tandis que le second pilier a été fortement ébranlé par le score dérisoire obtenu par le parti travailliste – 4 sièges seulement – ce qui lui vaut le triste privilège d’être la plus petite des dix formations politiques représentées à la Knesset.
Comment faire face à cette triple conjoncture ? Comment en est-on arrivé là et avec quel projet d’alternance crédible peut-on envisager de surmonter cette défaite ? Quelle alliance faudrait-il concevoir ensemble avec les Palestiniens ? Quel rôle les États-Unis, l’Union européenne et les opinions publiques devraient-ils jouer, et notamment la diaspora ? Toutes ces questions renvoient, en substance, aux deux interrogations majeures qui hantent un grand nombre d’Israéliens frappés de découvrir qu’ils sont une minorité à s’en inquiéter : la ch