La sociologie de la race n’est pas une importation états-unienne
La « race » constitue à bien des égards un objet politique traumatique, dont la mise en mots se fait rarement sans heurts. Les multiples controverses qui ont émaillé l’espace public français ces dernières années suggèrent souvent que les études sur les inégalités ethno-raciales en France minimisent les différences qui distinguent le contexte français de la situation états-unienne – quand bien même ces études se fondent sur des enquêtes empiriques. Ces critiques se doublent souvent d’une accusation plus fondamentale encore : le cadre épistémique et théorique dans lesquels ces études s’inscrivent serait lui-même « importé » des États-Unis. En d’autres termes, ce cadre épistémique et théorique serait étranger à la tradition nationale et serait un artefact diffusé par l’avant-garde intellectuelle états-unienne.
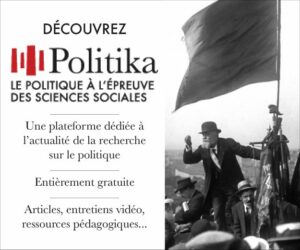
Ces critiques appellent plusieurs remarques. Premièrement, elles sous-entendent que ces études françaises partagent un même appareillage théorique, ce qui ignore la diversité des approches théoriques mobilisées dans l’espace scientifique français. Symétriquement, on peut aussi formuler un doute quant à la lecture qu’elles impliquent des débats théoriques outre-Atlantique : les ethnic and racial studies sont bien loin de constituer un monolithe et incluent au contraire des approches concurrentes. Deuxièmement, dans la mesure où elles font peu de cas du fait que les concepts maniés dans ces études sont appliqués à des enquêtes empiriques bien réelles, elles sous-entendent que la circulation globale des concepts est problématique en soi, quand bien même ils s’adosseraient à un travail de terrain ou à un recueil de données localisé. Troisièmement, elles vont bien souvent de pair avec des préoccupations politiques, dans la mesure où elles s’inquiètent d’une « mondialisation » du mouvement antiraciste qui serait guidé par son avant-garde états-unienne, prenant en exemple l’influence du mouvement Black Lives Matter. Quatrièmement, elles sont a minima simplific
