La guerre russo-ukrainienne, un conflit nationaliste
La guerre entre la Russie et l’Ukraine fournit un exemple de conflit nationaliste entre deux États[1], à condition qu’on utilise le terme « nationalisme » comme une catégorie d’analyse, libre a priori de tout jugement de valeur.
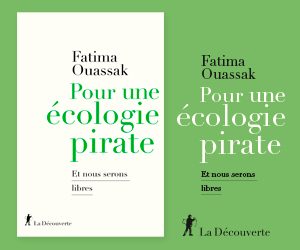
La première façon d’appréhender le concept de nationalisme est de le rapporter au principe moderne de légitimité politique selon lequel les peuples n’ont pas à être gouvernés par des étrangers, mais par les membres d’un même groupe ethnique ou national. Dans ce sillage, le nationalisme peut être défini comme « une forme de politique », axée sur les rapports de pouvoir dans un État et porté par des acteurs qui cherchent à exercer, ou exercent, le pouvoir étatique au nom de la nation. Celle-ci est susceptible d’avoir, et d’entretenir, une identité singulière permettant de la distinguer des autres nations. Les intérêts et les valeurs de la nation, sa souveraineté au premier chef, sont proclamés comme étant supérieurs à toute autre considération d’ordre individuel ou corporatiste[2].
Cette approche a le mérite d’accentuer le caractère éminemment politique du nationalisme et met en lumière sa dimension parfaitement rationnelle : le nationalisme résulte d’une volonté des acteurs de conquérir, de conserver et d’exercer le pouvoir, et ce malgré l’apparente irrationalité des revendications nationalistes, qui en appellent aux émotions collectives.
Si l’on retient cette définition du nationalisme « par la politique », il ne serait pas injustifié d’affirmer, statistiques en main, qu’il fut, et reste, un moteur clef de la guerre au cours des deux derniers siècles[3]. Les guerres interétatiques et les conflits civils ont en effet accompagné la généralisation de l’idée selon laquelle les peuples ont le droit de se gouverner eux-mêmes, sans pour autant aboutir à ce que la nation au sens plein du terme – communauté jouissant d’une souveraineté complète, d’un régime démocratique et d’une unité morale et culturelle – devienne une donnée universelle[4
