Ce que le tremblement de terre dit de la Syrie
Le 25 janvier, quelques jours avant le drame, devant le Conseil de Sécurité, Geir Petersen, l’envoyé spécial des Nations-Unies pour la Syrie, présentait un rapport dans lequel il estimait que « les Syriens sont prisonniers d’une crise humanitaire profonde, politique, militaire, sécuritaire, économique et touchant aux droits humains, d’une grande complexité et d’une échelle qui est presque inimaginable ». Avant même le tremblement de terre, la Syrie était un pays rendu exsangue par le conflit qui le ravage depuis douze ans.
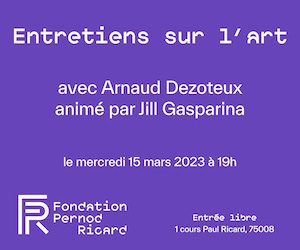
Dès 2012, le régime de Bachar al-Assad, aidé de l’aviation russe à partir d’octobre 2015, a en effet mis le ciblage des infrastructures civiles et des tissus résidentiels au cœur de sa stratégie de répression des zones échappant à son contrôle – sans cibler cependant celles tenues par le groupe État islamique à partir de 2013-2014. Entre 2015 et 2019, l’aviation russe a effectué une moyenne de 1200 raids par mois pour bombarder les villes et villages de Syrie.
Cette géographie de la destruction se superpose donc aux zones tenues par les groupes d’opposition. Ce sont elles qui ont été bombardées pendant des semaines, des mois, des années, en ciblant les quartiers résidentiels au mépris du droit humanitaire international, conduisant au départ en masse des populations. Ce fut le cas à al-Qosayr en mai-juin 2012, dans les quartiers orientaux d’Alep entre 2012 et 2016, dans la région de la Ghoutta (banlieue de Damas) jusqu’à sa reprise par le régime en avril 2018, pour ne donner que quelques exemples.
Plus encore, les infrastructures civiles ont été systématiquement visées : les marchés, les boulangeries devant lesquelles les gens font la queue pour s’approvisionner, mais aussi les écoles (la moitié sont impraticables), les hôpitaux, et les centres de santé dont la moitié ne sont plus en état de fonctionner. Les photos des destructions urbaines en Syrie ont fait le tour du monde, montrant des quartiers entièrement rasés, à Homs, Douma ou Alep
