À quand le tournant écologique de l’industrie musicale ?
«J’étais en pleine dissonance cognitive. J’avais arrêté la viande et les vêtements neufs, mais je prenais l’avion plusieurs fois par an pour jouer aux États-Unis et en Chine, j’utilisais une quantité invraisemblable de plastique dans le cadre du travail » raconte Solveig Barbier[1], l’une des fondatrices d’Arviva. Le Covid-19 et la pause qu’il a imposée a été l’occasion, pour cette musicienne classique, non seulement de réfléchir, mais aussi d’agir sur les pratiques professionnelles qui entraient en contradiction avec ses convictions personnelles.
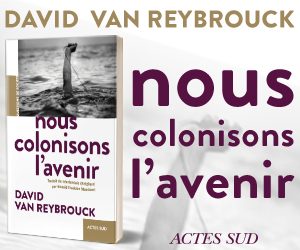
Arviva est donc née en 2020 dans le but « d’interroger les pratiques quotidiennes des métiers du spectacle vivant afin d’identifier des alternatives durables pour réduire l’impact environnemental de ce secteur ». L’association compte aujourd’hui plus de 200 adhérents. Elle forme les professionnels du spectacle vivant à la transition écologique, conçoit des critères d’évaluation pour des stratégies ambitieuses à long terme, intègre des principes d’éco-conception à la production de spectacles, entre autres. Et des formateurs, on en manque, selon Solveig Barbier, bien que certains se soient spécialisés dans le sujet, comme Green Room, Ipama et Terra 21.
Ce dont on manque sans doute encore plus, c’est de spécialistes du sujet au sein des sciences sociales. En effet, ces dernières n’ont pas véritablement saisi ni intégré l’ampleur de la crise environnementale en lien avec les milieux artistiques.
Selon Fabian Holt, la sociologie de l’art s’est développée en dehors de toute considération pour l’environnement, alors même que la relation au monde vivant est à la base d’un grand nombre de pratiques musicales, notamment traditionnelles et chamaniques.
Encore aujourd’hui, la prise en compte de l’écologie n’est pas aisée du fait des liens intrinsèques entre la notion d’art, l’exceptionnalisme humain et la modernité urbaine. On peut d’ailleurs faire le même constat pour la sociologie tout court. Si cette dernière a du mal à d
