La valeur travail bat-elle vraiment de l’aile ?
Expression polysémique par excellence, la « valeur travail » fait régulièrement l’objet d’appréciations contrastées dans le débat public. Manifestation d’un relâchement collectif qui nous mettrait en péril sur le plan économique et social, la crise de la valeur travail exigerait, pour les uns, que nous remettions le sens de l’effort au goût du jour. La rhétorique du « travailler plus » de Nicolas Sarkozy hier, celle qui teinte le projet de réforme des retraites d’Emmanuel Marcon aujourd’hui, constituent deux illustrations saillantes d’un tel point de vue. Quand elle n’est pas suspectée de véhiculer des représentations idéologiques douteuses, la valeur travail serait abîmée, pour les autres, par les conditions d’emplois de plus en plus dégradées ou encore par l’arrivée sur le marché du travail d’une génération friande d’un mode de vie plus respectueux de la vie personnelle.
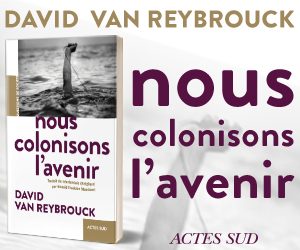
La publication récente de notes de l’Institut français d’opinion public (Ifop), conjointement avec la Fondation Jean Jaurès[1], a recueilli sur ce sujet un écho médiatique d’autant plus important que la thèse énoncée, celle d’un sévère déclin de l’importance accordée au travail, paraît aussi originale que spectaculaire. Elle est pourtant fondée sur une démonstration plus qu’insatisfaisante. Parce que ces notes ont précédé de peu les manifestations et les grèves contre le projet de réforme des retraites à l’occasion desquelles de nombreux protagonistes ont pris la parole sur la place du travail dans leur vie, il vaut de revenir sur les conditions de production d’un type de données qui, régulièrement, alimente un débat rarement avare de jugements à l’emporte-pièces.
L’évolution du sens et de l’importance accordés au travail
Comme toutes les catégories qui nous servent à percevoir et apercevoir le monde, celle de travail n’a rien d’universel. La sociologie s’est tôt penchée sur le sens et les représentations qui, historiquement, ont été associées à une pratique aux frontières aussi variables qu’évolutives. Le nom de Max Weber vient immédiatement à l’esprit à ce sujet. Sans entrer dans le détail de l’étude fondatrice publiée en 1904 et 1905 sur l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme[2], on peut néanmoins en retenir deux leçons de nature à justifier l’intérêt à prendre au sérieux, aujourd’hui encore, le travail en tant que valeur ou, si l’on préfère, de pourvoyeur de sens.
La première est que, en dépit de l’abstraction qui les caractérise, rien n’interdit de soumettre les valeurs à une analyse fondée empiriquement. Armé d’une telle exigence méthodologique, Max Weber a pu ainsi mettre en évidence l’existence au sein des sociétés occidentales modernes de relations d’affinités entre une éthique du travail saturée de puritanisme d’un côté, l’esprit du capitalisme de l’autre. La deuxième leçon que l’on peut tirer de l’analyse wébérienne des valeurs est une défiance à l’endroit des observations de court terme. Il aura fallu plusieurs siècles avant que le protestantisme n’impose à tous/tes, puritain·es ou non, une morale de la besogne dont a pu tirer profit le capitalisme occidental. En marchant sur les brisées de Max Weber, Daniel Bell en 1976, Luc Boltanski et Ève Chiapello en 1999[3], et bien d’autres encore, nous ont convaincu que les grandes respirations historiques qui ont rythmé la vie du capitalisme du siècle passé n’ont pas davantage laissé indemne notre rapport au travail.
Pour appréhender les transformations axiologiques des sociétés contemporaines, celles qui touchent au degré de valorisation des activités productives en particulier, on dispose par ailleurs de données quantitatives produites à l’occasion de grandes investigations empiriques à portée comparative[4]. Les enquêtes « valeurs » (European Values Survey, devenue ensuite World Values Survey) en sont l’un des supports majeurs. Lancées pour la première fois en 1981, elles reposent sur une double ambition : mesurer les valeurs dans de nombreux pays à travers le monde et suivre leurs évolutions dans le temps. Il s’agit, autrement dit, d’ériger les valeurs – entendues comme des idéaux qui structurent, sans jamais les déterminer simplement et mécaniquement, les opinions et les actions des individus[5] – au titre d’objets de science.
On peut à bon droit discuter des options théoriques et méthodologiques retenues par cette tradition de recherche, à commencer par la propension à la réification des cultures nationales. On peut aussi, dans le cas précis des enquêtes « valeurs », regretter que les opinions (dont on parie qu’elles permettent d’objectiver des idéaux partagés) soient principalement soumises à la question. Les attitudes et les comportements, en d’autres termes, échappent largement à l’investigation. Malgré de telles restrictions, une chose est certaine : ces enquêtes n’ont jamais validé la thèse d’une crise de la valeur travail en France.
Depuis les années 1990, elles observent plus exactement une stabilité de l’importance accordée au travail, cet « objet » occupant par ailleurs le haut de la hiérarchie des valeurs, tout juste derrière la famille et non loin devant les amis et les relations. En 1990, 60 % des enquêté·es tenaient ainsi le travail pour quelque chose de « très important » dans leur vie et 32 % d’« assez important ». Lors des investigations qui ont suivi, les résultats obtenus ont été les suivants : 69 % et 26 % en 1999 ; 68 % et 26 % en 2008 ; 62 % et 32 % en 2018[6]. La stabilité et des scores élevés caractérisaient donc, jusqu’il y a peu au moins, le degré d’importance accordée au travail par les français·es, avec quelques variations il est vrai selon le sexe, l’âge ou encore la profession.
Une si soudaine révolution ?
Une enquête commanditée par la Fondation Jean Jaurès auprès de l’Ifop est venue récemment bouleverser nos certitudes. Voilà que désormais le travail ne recueille plus que 24 % d’avis « très importants » et 62 % d’« assez importants ». L’étude, qui compare ces résultats à ceux de l’enquête « valeurs » de 1990 exclusivement, conclut à rebours de ce que nous a enseigné la sociologie historique wébérienne que « nous assistons à une évolution rapide des mentalités[7] ». Le titre du premier document qui rend compte de ce coup de sonde est plus explicite encore : « “Plus rien ne sera jamais comme avant” dans sa vie au travail[8] ». Si l’affirmation paraît tranchée, il faut rendre grâce à son auteur de préciser que l’investigation porte sur la place que les individus accordent au travail dans leur vie, non sur les jugements qu’iels portent sur le contenu de leurs activités professionnelles.
Plusieurs indicateurs d’ « évaluation du rapport au travail » (satisfaction envers le contenu de son travail, satisfaction envers l’intérêt pour son travail, satisfaction envers l’équilibre vie privée/vie professionnelle) sont ainsi mobilisés pour persuader que, à l’inverse de la valeur qui lui est accordée, le rapport au travail se serait bonifié depuis les années 2000, les taux de satisfaction des trois indicateurs atteignant respectivement, en 2021 , 81 %, 76 % et 75 %.
On a du mal, il faut bien l’avouer, à comprendre la pertinence de la distinction ainsi proposée. S’il est possible de concevoir qu’un emploi jugé riche et intéressant puisse s’accommoder d’une volonté de ménager plus de place à des préoccupations personnelles, est-on sûr en revanche que, dans les enquêtes, les individus ne jugent pas aussi l’importance du travail dans leur vie à l’aune d’un tel critère ? La note elle-même entretient la confusion puisque, deux pages à peine après qu’aient été opposés place et contenu du travail, il est indiqué que, pour les salarié·es, le bon score associé à l’affirmation « avoir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle » confirme que le travail occupe une nouvelle place dans l’existence des salarié·es. Même en faisant fi d’une telle contradiction, la conclusion à laquelle aboutit l’étude ne manque pas de toutes les manières d’étonner par sa témérité : « beaucoup de salariés ne lui [le travail] confèrent plus une fonction statutaire essentielle. Il constitue moins un marqueur d’inscription sociale ou un levier de bonheur. Cette perception du travail est enfin homogène selon les différentes catégories de salariés[9]. »
Qu’il y ait matière à interrogation et à discussion à propos d’une affirmation qui prend à contre-pied le savoir accumulé depuis de nombreuses années par les sciences sociales sur le sujet n’a pas empêché plusieurs médias de relayer bruyamment le message, en le simplifiant parfois à l’extrême. Puisque seul·es 24 % des français·es estiment désormais que le travail occupe une place essentielle dans leur vie (le qualificatif « très important » n’étant pas toujours mentionné), comment douter que la valeur travail batte aujourd’hui de l’aile ? Rares en revanche sont les commentateurs·rices à avoir douté de l’étanchéité absolue entre les réponses « très importantes » et « assez importantes » proposées aux enquêté·es et à avoir remarqué que lorsque l’on subsume les résultats sous une unique catégorie « important » (comme le propose pourtant la note de l’Ifop), la chute est autrement moins spectaculaire. On passe en effet de 92 % de « très importants » et d’« assez important » en 1990 à 86 % en 2021 et à 84 % en 2022.
Les pièges de la comparaison
L’auteur de la note dont il vient d’être fait mention ne peut être tenu, à l’évidence, pour responsable des interprétations hâtives voire erronées qui ont pu être faites de ses résultats, ni de l’accueil plus discret réservé à d’autres études aux conclusions plus tempérées[10], ni encore du moindre impact d’autres éclairages fournis par l’Ifop (au profit toujours de la Fondation Jean Jaurès) qui concluent qu’un français sur trois aurait été atteint, en raison du Covid-19, par une « épidémie de flemme[11] » (sic). Il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où cette note a fait grand bruit et que sa publication, suivie d’une deuxième en janvier 2023, est intervenue dans un moment où les questions de travail ont commencé à nouveau à nourrir les polémiques, il importe d’aller plus loin dans l’examen.
Comme on l’aura compris, dans les notes de juillet de 2022 et de janvier 2023, la thèse à laquelle aboutit l’Ifop prend appui sur les réponses à une question posée en 2021, puis à nouveau l’année suivante. « Pour chacune des choses suivantes, pouvez-vous me dire si, dans votre vie, cela est très important, assez important, peu important ou pas important du tout ? ». Les choses en question sont la famille, le travail, les amis et relations, les loisirs, la religion et, enfin, la politique. La formulation est rigoureusement identique à celle qu’utilisent depuis longtemps déjà les enquêtes « valeurs ». Très générale, cette interrogation sert d’entame au questionnaire fabriqué, à des fins comparatives, par ces enquêtes récurrentes. En 2018, l’ensemble comportait une centaine de questions assorties dans la plupart des cas d’un nombre limité de réponses possibles.
On comprend aisément, du moins a priori, l’intérêt qu’a pu trouver l’Ifop à rédupliquer en 2021 une question sur l’évolution de la valeur travail, question qui avait déjà été posée au cours des années et des décennies précédentes. On comprend déjà moins en revanche pourquoi les résultats publiés prennent 1990 comme unique point de repère de la comparaison, et non 2018 qui bénéficie encore d’une appréciation extrêmement positive de la part des Français·es s’agissant de l’importance accordée au travail dans leur vie (cf. supra). Passer un tel élément sous silence, n’est-ce pas fabriquer de toutes pièces un biais d’interprétation qui peut pousser à croire que le début du déclin date de plus de trois décennies déjà ?
Mais le vrai problème est ailleurs. Le souci majeur est qu’en extrayant une interrogation du corpus dans lequel elle prend habituellement place, on se condamne à comparer l’incomparable et donc à fragiliser à l’extrême les conclusions qu’il est loisible de tirer à propos de l’évolution sur moyen terme de la valeur travail. Plusieurs difficultés limitent, pour être plus exact, la pertinence d’une telle opération. La première concerne les populations de référence. Les enquêtes « valeurs » ciblent tous les individus, actifs et non actifs, âgés de 18 ans et plus, résidant en France (sur le territoire métropolitain) dans un ménage ordinaire au sens de l’Insee[12]. En 1990, l’échantillon (n = 1 002 individus) de l’enquête avait été constitué à l’aide de la méthode des quotas. Côté Ifop, la première note indique simplement que « l’essentiel de l’analyse porte sur la population active salariée, soit 90 % des personnes actuellement en poste[13] », la seconde que l’enquête de 2002 a été effectuée « auprès d’un échantillon représentatif de 1 300 salariés[14] ». À la différence de l’enquête « valeurs », les inactifs·ives, les chômeurs·euses et les non-salarié·es ont donc, semble-t-il, été exclu·es du coup de sonde qui a abouti au chiffre de 24 % évoqué précédemment. Si tel est bien le cas, et sans même considérer les éventuelles différences de frontières d’âge retenues dans les deux enquêtes, on ne peut se permettre de comparer terme à terme les résultats obtenus par l’enquête « valeur » de 1990 avec ceux de l’Ifop en 2021 en 2022.
Deuxième difficulté : si les enquêtes « valeur » nous renseignent sur les taux de non-réponse (il est de l’ordre de 2 % s’agissant de la question posée en 1990 à propos de l’importance accordée au travail), tel n’est pas le cas côté Ifop. À la différence des enquêtes « valeur », les pourcentages publiés ne s’appliquent qu’aux seules réponses exprimées. Cet autre biais interdit lui aussi une comparaison terme à terme et donc à nouveau, en toute rigueur, l’énoncé d’une conclusion aussi abrupte que celle qui a fait le délice de certains médias.
Les pièges de la sémantique
Ce n’est pas tout. Reproduire un questionnement utilisé par une autre enquête sans se soucier du contexte, qui a justifié le choix des termes de l’interrogation, pose d’autres problèmes encore. Parce qu’elle répond à des contraintes de comparabilité internationale, la formulation des interrogations et des réponses proposées dans les enquêtes « valeurs » exige de pouvoir être comprise à peu près de la même manière par l’ensemble des populations des multiples pays investigués. Or, en dépit des précautions prises, les ambiguïtés d’un questionnement sur la place conférée au travail dans la vie ne sont pas mineures.
Le terme « importance » peut revêtir d’abord des significations sociales multiples. Comme plusieurs enquêtes françaises l’ont mis en évidence au cours des dernières années, ce qui importe aux yeux des cadres, grâce à l’exercice de leurs activités professionnelles, n’équivaut pas à ce qui est valorisé par les ouvriers et les ouvrières. L’enquête effectuée sous la direction de Christian Baudelot et de Michel Gollac il y a quelques années déjà[15] a ainsi montré que, pour celles et ceux qui habitent le haut de la hiérarchie sociale, le travail importe parce qu’il est facteur d’épanouissement (c’est une composante du bonheur) tandis que pour les locataires du bas il est important dans la mesure où, à défaut des revenus qu’il permet de percevoir, la vie est difficile (le travail est alors une condition du bonheur). Dans les deux cas, le travail importe mais pas du tout pour les mêmes raisons.
Le terme de travail est tout aussi ambigu. Que recouvre-t-il exactement ? La somme des actions que l’on effectue chaque jour pour effectuer une tâche ou alors le statut dont il est possible de jouir grâce à l’occupation d’un poste rémunéré ? Dans le premier cas, il s’agit plutôt de travail stricto sensu, dans le second d’emploi. Telle qu’elle est formulée, la question sur la valeur à accorder au travail charrie en réalité la possibilité d’opter pour l’une ou l’autre de ces significations, sans que l’on ne puisse savoir, même si l’on peut faire quelques hypothèses à ce sujet, quel registre d’interprétation est privilégié par les répondant·es à l’enquête. Dans la version matricielle de l’enquête « valeur », rédigée en anglais, le terme work est utilisé, non celui de labor (qui, à la différence de work, désigne explicitement les conditions matérielles d’effectuation d’une tâche). Le français ne permet pas malheureusement d’opérer une telle distinction.
Conscients d’une telle difficulté, mais aussi des limites liées au fait de proposer un nombre limité de réponses aux interrogations posées, les responsables des enquêtes « valeurs » font le choix de démultiplier des questions connexes à celles qui peuvent être sources d’ambiguïtés. C’est là une stratégie utile afin de mieux objectiver la perception des phénomènes que l’on cherche à mesurer. C’est ainsi que dans l’enquête de 1990, comme dans celles de 1999 et de 2018, il est demandé aux enquêté·es ce qu’iels pensent de l’affirmation en vertu de laquelle « le travail devrait avoir moins d’importance ». Parce qu’elle fait écho à celle qui, dès le début du questionnaire, teste l’avis des individus sur l’importance accordée au travail et que, par ailleurs, elle aboutit parfois à des résultats contre-intuitifs, cette autre interrogation permet de gagner en finesse d’analyse. En 1999, par exemple, alors que 69 % des sondé·es estiment que le travail tient une place très importante dans leur vie, iels sont aussi 64 % à penser que devoir lui accorder moins d’importance est une « bonne chose ». À la même date et dans la même enquête, 34 % se disent d’accord avec l’idée que « le travail doit toujours passer en premier[16] ».
En croisant de la sorte les interrogations, on se garde des interprétations hâtives auxquelles peuvent donner prise un ou deux chiffres isolés. Les notes de l’Ifop et de la Fondation Jean Jaurès font bien référence à quelques autres questions issues d’enquêtes (« Normes Ifop de climat social 2021 et 2022 ») d’où sont tirées les données sur l’importance accordée par les Français·es au travail. Mais, autant que l’on puisse en juger, aucune malheureusement n’est de nature à affiner ni à conforter la thèse de la perte de centralité de la valeur travail, surtout de façon aussi abrupte que ne le laissent penser certains passages des documents en question.
Une esquisse d’interprétation qui peine à convaincre
À défaut de pouvoir s’appuyer sur un dispositif méthodologique probant, les hypothèses et les arguments qualitatifs suggérés pour comprendre pourquoi « la proportion de Français en activité affirmant que la place du travail dans leur vie était ‘très importante’ » s’est « effondrée en un peu plus de 30 ans, passant de 60 % en 1990 à 24 % en 2021 » nous aident-ils davantage à fortifier notre intelligence de la situation présente ?[17] En filigrane dans l’ensemble des notes rédigées pour et avec la Fondation Jean Jaurès, l’idée que la crise du Covid a précipité des mutations déjà en germe de longue date paraît a priori plutôt heuristique. Mais, sur ce terrain, on peine aussi à être convaincu.
Agrémentées de citations et d’illustrations extraites d’un matériau extrêmement hétéroclite (journaux et magazines à grand tirage, internet, témoignages tirés du chapeau…), les multiples pièces du puzzle ici assemblées sont parfois contradictoires et surtout toutes aussi discutables les unes que les autres. Certaines mobilisent hâtivement des notions, comme celles de mentalité, de passion, d’individualisme, de génération…, qui exigeraient de plus amples précautions d’usage. D’autres prennent à leur compte des constats déjà fort anciens, le refus des cadres de travailler sans compter leur temps par exemple, qui n’aident guère à éclairer la soudaineté du basculement observé. D’autres encore reposent sur des affirmations factuellement contestables, comme celle de la « disparition des mondes ouvrier et paysan[18] ».
Il n’est peut-être que l’attention portée (dans deux des documents publiés par l’Ifop et la Fondation Jean Jaurès) aux évolutions du temps de travail qui pourrait convaincre de l’argumentaire d’ensemble. N’assiste-t-on pas en effet à une diminution presque constante de la durée effective du travail qui, en France, est passée d’un peu plus de 1 950 heures par an au milieu des années 1970 à environ 1 550 heures aujourd’hui ? Une telle évolution n’est-elle pas de nature à chahuter tendanciellement la valeur travail ? Si la réponse à cette dernière interrogation était positive, reste alors à savoir pourquoi, jusqu’à 2018 au moins, les enquêtes « valeurs » enregistrent sans discontinuer de hauts scores concernant l’importance conférée à la valeur travail dans la société française (cf. supra). On a du mal à croire, plus exactement, que l’on puisse imputer au seul Covid-19 l’« évolution radicale de l’état d’esprit d’une grande partie des salariés en seulement deux ans [19] ».
Il est vrai, qu’avec l’épisode du Covid-19, certaines personnes ont pu prendre goût avec le télétravail au charme d’une activité moins fréquemment cadrée par un environnement de bureau. La crise sanitaire n’a pourtant pas radicalement mis en cause le rapport des Français·es au travail. Assortie d’une investigation de nature qualitative, l’exploitation des données de l’enquête Evrest menée entre octobre 2020 et avril 2021 a permis de montrer que seul·es 10 % des salarié·es avaient le sentiment que leur travail avait perdu de son sens en raison de la crise sanitaire, contre 61 % qui ont pu déclarer une absence de changement et 29 % un gain d’intérêt[20]. Même si, il est vrai, les effets varient quelque peu selon le sexe, l’âge et la classe sociale, impossible décidément d’en conclure que la valeur travail a fortement souffert du Covid-19.
Au-delà des opinions
Si, en dépit d’implicites discutables et de limites souvent commentées, les sondages d’opinion méritent qu’on prête attention aux résultats qu’ils peuvent nous fournir, ces derniers ne remplaceront jamais l’analyse du travail telle que les sciences sociales permettent de les appréhender à l’aide de leurs outils de prédilection. L’immense majorité des enquêtes menées en sociologie, ergonomie, psychologie, économie, science politique… propose plus exactement de regarder les réalités des mondes professionnels autrement qu’en termes d’état d’esprit de la population française. Elles livrent des résultats dont l’un des premiers mérites est de se défaire de la normativité qui irrigue trop de propos sur la valeur travail. La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail a ainsi montré récemment qu’après une chute en 2020, imputable à l’usage de dispositifs (comme le chômage partiel) qui ont servi à endiguer les effets du Covid-19 sur la marche du système productif, le temps de travail annuel effectif est revenu en 2021 à un niveau quasiment similaire à celui de l’avant-crise[21].
En 2021, indique plus exactement la Dares, cette durée était de 1 567 heures, ce qui correspondait à un temps de travail moyen de 36,9 heures au cours d’une semaine habituelle pour tous les actifs quel que soit leur statut (les temps partiels inclus par voie de conséquence). Si d’aventure elle a existé, la « grande flemme » n’aura donc été qu’un épisode très vite clos par la grande majorité des actifs·ives occupé·es.
Ce retour au même ne signifie pas pour autant que rien ne change. Sur le plan de l’organisation des activités, par exemple, on ne manque pas d’enquêtes quantitatives et qualitatives pour objectiver des tendances marquantes. Tandis que, mesurée à l’aune des principes structurants du vieux modèle taylorien, l’autonomie au travail a crû tendanciellement au cours de ces dernières décennies, les conditions de travail se sont en revanche durcies, avec les conséquences néfastes sur la santé que l’on connaît[22]. Pour ne prendre qu’une seule illustration encore empruntée à la Dares, la proportion de salarié·es qui déclarent que leur travail est répétitif a plus que doublé entre 1984 (elle était de 20 %) et 2016 (près de 42 %). Corinne Gaudart et Serge Volkoff ont éclairé récemment l’un des aspects décisifs de cette intensification de l’activité dont ne rendent guère compte les sondages d’opinion qui enregistrent des degrés de satisfaction au travail.
À l’aide d’un abondant matériau empirique, Corinne Gaudart et Serge Volkoff pointent du doigt les effets pathologiques des injonctions liées à ce qu’iels nomment le « modèle de la hâte ». Un tel paradigme nous enjoint de travailler toujours plus vite et en faisant toujours mieux. En réalité, cette flexibilité de l’extrême interdit de bien travailler, de pouvoir discuter collectivement de sa pratique mais aussi de transmettre ses savoirs. À l’heure où les exigences de rendu des tâches effectuées n’ont jamais été aussi pesantes, la hâte nourrit des sentiments malsains de culpabilité personnels chez celles et ceux qui, faute de moyens ou en raison d’injonctions contradictoires, n’arrivent pas à tenir dans les temps les objectifs qui leur ont été personnellement assignés[23].
Intimement liée à celle du sens au travail[24], la question de la reconnaissance au travail demeure tout aussi vive aujourd’hui. En 2016, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) estimait que plus de la moitié des salarié·es déploraient un manque de reconnaissance pour le travail qu’iels effectuaient. Et même lorsque des leviers étaient activés pour dissiper l’invisibilité des engagements, la solution était loin d’être parfaite : la majorité des politiques d’entreprise étaient en effet tournées vers la valorisation des résultats plutôt que vers celle des efforts. L’éphémère et symbolique reconnaissance dont les personnels médicaux et para-médicaux ont pu bénéficier durant la crise sanitaire est loin, on le sait, d’avoir réglé le problème. Puisque à de trop nombreux endroits, à l’hôpital et à l’université au premier chef, les moyens matériels ne suivent pas, comment s’étonner dès lors, qu’à force d’épuisement et d’invisibilité, la vocation qui faisait le sel du Beruf wébérien ne soit plus un ressort à même d’animer l’engagement de celles et ceux qui, bien loin de flemmarder, ont tant donné d’eux/elles-mêmes au cours de ces dernières années ?
