Le stock, nouvel avenir de la ville
Alors même qu’ils étaient considérés comme quasi-sacrés durant plusieurs millénaires, les lieux du stockage sont perçus aujourd’hui comme des entraves au développement des villes. Le prestige s’incarne désormais dans tous les lieux qui concrétisent l’agilité, l’innovation de dépassement, le just-in-time. Le privilège urbain et architectural est ainsi accordé à toutes les installations qui concourent à la performance de la chaîne de distribution des biens et des services, transformant les villes, et plus particulièrement leurs centres, en des espaces purement servis, d’où toute production serait exclue.
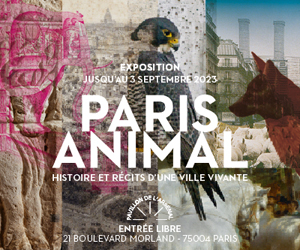
La révolution numérique est devenue le moteur principal de ce mirage d’une ville constamment sous flux tendu, réduisant d’autant l’intérêt architectural que nous pourrions porter à la matérialité du stock et de l’archive. La logistique urbaine est devenue un des déterminants principaux de cette dissolution du stock[1]. Les entrepôts qui lui sont consacrés ne remplacent pas les réserves et les greniers : ils les vident de leurs substances en s’assurant de la mise en mouvement de toutes les provisions.
Le stock n’a pas pour autant disparu – ses contenants ont même acquis des dimensions considérables, tels les datas-centers[2] ou les sites de self-stockage –, mais il a quitté la ville pour s’installer à la campagne, là où le foncier est moins cher et où il n’y a plus aucun risque d’interférer avec la vie urbaine. Il existe certes des lieux de stockage en ville mais ils demeurent petits et marginaux. Ils restent pour la plupart dissimulés, voire camouflés, traduisant ainsi tout le mépris qu’on leur porte.
Mais pour combien de temps encore ? Les perspectives d’épuisement des ressources pourraient bien, à court terme, nous amener à reconstituer des réserves et à revaloriser la fonction même du stockage. Une telle revalorisation ne contribuerait pas seulement à réduire les gaspillages générés aujourd’hui par le flux tendu (production inutile, gaspillage, extension
