Crise politique ou démocratie évidée ?
La conjoncture sociale et politique est éclairante sur ce qui se joue dans la confrontation entre opposants à la réforme des retraites et gouvernement. Pas besoin de la victoire électorale d’une extrême droite vindicative pour dénaturer les valeurs, les idées et les pratiques constitutives d’une société démocratique et faire perdre à cette utopie émancipatrice tout son sens libérateur.
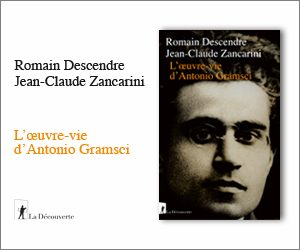
Il suffit de laisser agir les élites au pouvoir actuelles. Si la situation présente est déplorable, on peut lui reconnaître néanmoins une vertu : celle de livrer au grand jour ce qui reste habituellement tacite (enfin de moins en moins depuis 2007 et la présidence Sarkozy qui a tout d’un précédent inspirant) et de déciller les yeux sur ce à quoi et à qui l’on a affaire depuis 2017 et l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée. Il ne s’agit plus de « haine de la démocratie » ou « d’ignorance sociale » comme certains l’affirment, mais d’une profonde indifférence à l’égard du sort de tous ceux (c’est-à-dire la quasi-totalité des groupes sociaux) qui n’appartiennent pas à l’entre-soi mondain du pôle économique des fractions hautes des classes supérieures.
« Bien nommer les choses est le préalable indispensable pour conjurer le pire » écrit Michael Foessel dans son ouvrage Récidive : 1938 dans lequel il suit l’idée d’une analogie entre cette fin des années 1930 et la période actuelle avec « le sentiment tenace qu’il y a des revenants dans l’histoire ». Des revenants qui, hélas, n’ont rien de comiques à l’inverse de ce que pouvait en penser Marx (pour une fois il n’avait pas tout à fait raison).
L’antidémocratisme, pour ne pas dire plus, s’affiche au plus haut niveau de l’État et de son entourage technocratique et politique sans qu’il y ait nécessité d’un « populisme » vulgaire et sans grande vision philosophique. Il n’est pas sûr ainsi qu’il y ait aujourd’hui une crise politique ou alors elle n’est pas située là où on le pense. Mais qu’il y ait un scandale démocratique, cela n’est pl
