Religion et droit civil – à propos des Guet Laws
La guerre des dieux a repris en France. La récente polémique sur la nomination de nouveaux membres au « Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République » montre à quel point les positions sont inconciliables : trop de souplesse dans le commerce avec la religion pour les uns, pas assez de frontières entre le politique et le religieux pour les autres, le débat échappe rarement aux formules toutes faites.
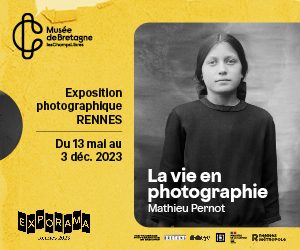
Le mur de séparation que l’on dresse entre l’Église et l’État n’a pas la consistance qu’on lui prête. Il n’a qu’un statut de second ordre permettant de protéger les valeurs premières de liberté et d’égalité. Dans les pays de common law, les règles concrètes qui ordonnent la coexistence des mondes sont une affaire d’interprétation et se jouent dans les cours de justice. Cela pourrait être vrai en France si l’on voulait prendre au sérieux la souplesse dont le sécularisme constitutionnel peut faire preuve lorsqu’il s’agit de défendre nos valeurs fondamentales, ou la variété des conjugaisons possibles entre la séparation formelle d’un côté et les compositions plus compréhensives entre État et Églises de l’autre. Nous savons qu’il n’y a pas de définition consacrée de la laïcité, que ce n’est ni un principe univoque ni un concept épais. C’est une pratique : il n’y a pas plus de définition consensuelle de la laïcité ici qu’il n’y a de mur entre le politique et le religieux aux États-Unis. Car qui dit séparation dit à la fois protection (de chacune des sphères) et nécessaire interaction. Plus que le dogme importe le pragmatisme démocratique.
Pour apprécier le pragmatisme contextuel, il faut observer une série de lois et de décisions qui n’hésitent pas à bousculer les frontières et à produire des équilibres novateurs. Compatibles avec le Premier amendement, jamais révoquées, les « Guet Laws » de l’État de New York en sont un bon exemple. On les retrouve au Canada, au Royaume Uni, en Afrique du Sud sous une forme analogue.
Certains se souviennent peut-
