Erdoğan vs. Kılıçdaroğlu : deux modèles de société pour la Turquie
Parfois hâtivement réduit à une alternative entre autoritarisme et démocratie, le choix qui se présente aux électeurs turcs ce dimanche 14 mai met surtout en jeu deux conceptions de la gouvernance moderne. D’un côté, celle qui repose sur un leader puissant, concentrant les pouvoirs dans une logique césariste ; de l’autre, celle qui s’appuie sur le consensus et la négociation entre structures partisanes. Homme fort, au risque de l’autoritarisme, ou régime d’assemblée, au risque de l’instabilité ? Ce questionnement traverse nombre de régimes politiques contemporains, de l’Inde à Israël, en passant par le Brésil ou même certaines démocraties européennes, dont la France.
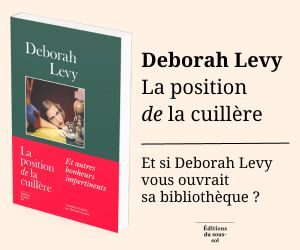
Au-delà de cette question symbolique, c’est aussi parce qu’elle est devenue un acteur clé des relations internationales que l’avenir politique de la Turquie intéresse. C’est pourtant là qu’il convient de ne pas en surestimer les enjeux. Il est courant de lier les difficultés économiques du pays, sa politique étrangère disruptive et parfois déroutante, et son inflexibilité dans les affaires stratégiques, à la seule figure de Recep Tayyip Erdoğan. Les réalités sont plus complexes : nombre de tendances que l’on observe aujourd’hui en Turquie sont structurelles. Une victoire de l’opposition traduirait et refléterait les évolutions de la société turque, mais n’entrainerait pas une vraie rupture dans la logique stratégique et diplomatique du pays.
Le régime ultra-présidentiel mis en place au cours des dernières années a fait des élections une affaire de personnalité davantage que d’idéologie. Les projets de société qui s’affrontent portent sur le président Erdoğan et le modèle institutionnel qu’il a mis en place, pas sur le fond de son discours au monde. Cette situation favorise la création de coalitions hétéroclites, construites pour répondre à des impératifs politiques, souvent de court terme, et non pour porter une vision globale du rôle de la Turquie. De ce fait, quel que soit le scénario envisa
