Vexillopédie d’État
Picrochole à l’Assemblée nationale. C’est quasiment en ces termes que des députés de l’opposition ont dénoncé la tentative gouvernementale de faire passer, au cours des débats des 9 et 10 mai derniers, la proposition de loi « visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européen sur le fronton des mairies ».
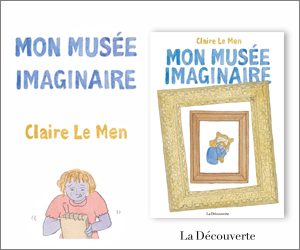
Au fil de la séquence législative, Picrochole n’a pas été convoqué ; la fameuse querelle byzantine sur le sexe des anges l’a été en revanche plus qu’à son tour. L’agenda social est encore bouillant des luttes engagées contre la loi sur la retraite que le drapeau fait son grand retour. En fait, il ne quitte que rarement la scène même si c’est épisodiquement qu’on le fait ou qu’on le voit agir.
Installée le 31 décembre 2021 sous l’Arc de triomphe pour marquer l’ouverture de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la bannière bleue aux douze étoiles avait alimenté les critiques des leaders de la droite et de l’extrême droite (Pécresse, Le Pen et Zemmour). Énième preuve d’une majorité parlementaire et d’un gouvernement hors-sol, le pavoisement tombe à point nommé pour fustiger les errements d’un pouvoir troquant volontiers le symbolique contre le social, le drapeau contre le pouvoir d’achat, l’écume des jours contre le règlement des problèmes pendants : ce 11 mai, alors que Dominique Simonnot, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, déplorait matinalement sur France Inter l’état catastrophique des prisons françaises et l’indifférence ministérielle pour redonner un peu de dignité aux personnes incarcérées, la présentatrice du Journal de 7 heures revenait sur l’adoption de la loi, « au terme de deux soirées de bruit et de fureur », qui obligera en fin de compte le double pavoisement des mairies dans les communes de plus de 1 500 habitants (quelque 20 % des 35 000 communes françaises).
Comme tout personnage emblématique des XVe-XVIe siècles, Picrochole était entouré de gonfanons, de guidons et d’éten
