Décivilisation : prendre Elias au sérieux
Les mots, accessibles à tous, ne sont la propriété de personne. C’est ainsi qu’un jeune prétendant à la présidence de la République, idéologiquement ancré dans la droite libérale-conservatrice, a pu ériger le terme « révolution » en un mot d’ordre de sa campagne sans qu’on puisse formellement lui en faire grief.
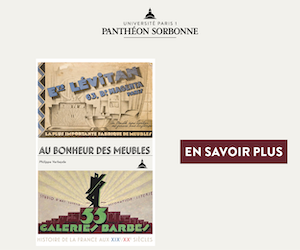
Toutefois, il est évident que son usage de ce mot s’écarte de la signification émancipatrice qui lui est traditionnellement prêtée par la gauche politique. Pour le candidat, devenu président, le mot « révolution » exprime la volonté d’intensifier l’emprise de la dynamique d’accumulation capitaliste sur l’État et la société. Et bien que cette dynamique menace de façon avérée la survie de l’humanité, cela n’altère en rien son droit de qualifier cette ambition de « révolutionnaire », tant qu’il est sans équivoque dans sa communication et qu’il n’induit pas le public en erreur.
Ce qui vaut pour le mot « révolution » s’applique mutatis mutandis au mot « décivilisation », récemment prononcé par ce même président de la République pour poser un diagnostic sur les maux qui affligent la société française et exhorter le gouvernement à agir. Ce terme résonne facilement avec les fantasmes d’idéologues d’extrême droite, à l’instar de Renaud Camus, qui l’a inscrit en titre d’un livre paru en 2011. Cependant, la sémantique de la « décivilisation » véhiculée dans cette littérature – si on peut l’appeler ainsi – rend alors inenvisageable de se réfugier derrière la référence au sociologue Norbert Elias, opportunément brandie par l’entourage du président pour justifier ce choix lexical. Ce serait comme prétendre que le mot « révolution » avait été employé par le futur président de la République dans l’esprit de Karl Marx ou d’Auguste Blanqui, plutôt que dans un sens proche de celui que lui donnaient Milton Friedman ou Margaret Thatcher.
Malgré le halo droitier qui, dans le contexte politique actuel, se dégage du mot « décivilisation » – un fait que de nombreux comment
