Au commencement était Silvio Berlusconi
Il y a quelques années Antonio Gibelli, spécialiste de la Première Guerre mondiale, s’était aventuré à écrire un court essai intitulé Berlusconi passato alla storia, littéralement Berlusconi entré dans l’histoire.
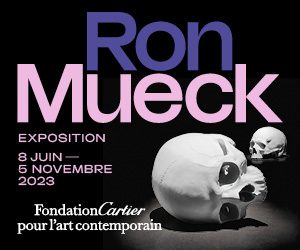
À la même époque, d’autres historiens, experts de la période fasciste et de ses suites, parmi les esprits les plus aiguisés du champ historiographique italien, s’intéressaient également à l’homme politique milanais : Gabriele Turi, Nicola Tranfaglia, Paul Ginzborg ou Gianpasquale Santomassimo[1]. Le petit livre de Gibelli visait à dessiner les contours de ce qu’il nommait l’« ère berlusconienne » dans l’espoir de « congédier définitivement le personnage », et exorciser le « Draquila » dépeint dans le documentaire de Sabina Guzzanti en 2010. Le problème qui se posait ne consistait pourtant pas, comme le voyait d’ailleurs bien l’ensemble de ces analystes, à se débarrasser de l’homme Berlusconi, mais de la culture dont il était l’interprète[2]. La même année, Mario Monicelli, le réalisateur inoubliable du film Le Pigeon (I soliti ignoti, 1958), répondait, désabusé, à une interview transmise lors de l’émission en direct de Michele Santoro « Rai Per una notte »[3]. Il y traçait le portrait d’un pays soumis, la peur au ventre qui n’avait jamais connu la « révolution ». Il espérait un « grand coup (bella botta) [contre le système] », parce que, soutenait-il, la rédemption ne surgira que du sacrifice et de la douleur.
Le réalisateur italien semblait n’envisager ni l’éventualité, ni (encore moins) l’opportunité de se débarrasser seulement de Silvio Berlusconi. Il avait bien compris alors qu’il ne s’agissait pas uniquement de déloger un homme du gouvernement, mais bien de se libérer du berlusconisme; « une idéologie éclectique composée de populisme, d’individualisme exacerbé, de révisionnisme historique, de l’utilisation instrumentale et identitaire de la religion »[4]. En bref, de transformer la société italienne au sein de laquelle s’était sédimentée une
