Le Code de la rue, bien plus qu’une histoire de mobilité urbaine
En envisageant de mettre en place un Code de la rue durant l’été 2023 pour répondre aux préoccupations de ses habitants concernant la sécurité routière, la ville de Paris poursuit sa lancée pour pacifier ses rues et rééquilibrer le partage de l’espace public.
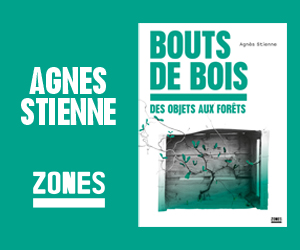
Mais au-delà du changement de paradigme de mobilité que nécessite la transition écologique de la ville dense, c’est une opportunité pour les habitants de faire évoluer les modes de vie en milieu urbain. Loin des polémiques liées à la vitesse ou de l’idéalisation de la ville-village souvent maladroitement induite derrière l’urbanisme de proximité, les habitants ont un rôle à jouer pour se servir de l’espace public afin de retrouver une délibération publique qui a besoin d’expériences d’altérité plus abouties. Plus que de bonne morale, il s’agit plutôt d’un projet philosophique pour la ville.
Le terme de Code de la rue s’est installé en 2003 en Belgique en s’introduisant dans l’ancien Code de la route afin de « modifier les mentalités et les comportements des divers usagers, de manière à organiser un partage équilibré de l’usage de la voie publique ». Cela signifie un changement de philosophie crucial dans la gestion de la voie publique dont on reconnait ainsi les caractéristiques sociales et où l’on donne la priorité aux plus faibles, piétons et cyclistes. Depuis lors, le concept a été largement diffusé dans d’autres pays et notamment en France où il a inspiré une réforme législative en matière de sécurité routière en 2008[1]. À l’origine, il émane de la mobilisation d’associations de défense des usagers de la rue face à l’augmentation des accidents de piétons et de cyclistes. Elles réclament des mesures pour pacifier la circulation et réduire la vitesse des véhicules motorisés en s’appuyant sur de nombreuses expériences d’aménagement qui ont fleuri dans toute l’Europe dès les années 1970.
Parmi elles, l’association « Rue de l’Avenir » s’était fortement mobilisée dès les années 1980, publiant une série
