Espagne : la détransition en 10 leçons
25 mai 2015 – 28 mai 2023 : ces dates encadrent les deux mandats de quatre ans au cours desquels s’est déployé un néo-municipalisme à l’espagnole. Des plates-formes citoyennes adossées à des majorités progressistes ont pris les rênes de nombreuses villes en promettant de tout changer[1]. Une partie de ces équipes ont été remerciées dès 2019, le reste des équipes a disparu fin mai dernier.
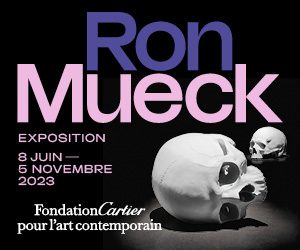
Cette débâcle suit de peu la défaite de la gauche municipale grecque de 2019, qui a préparé l’arrivée de la droite aux élections générales de 2023. Même alignement en Italie où les récentes consultations municipales annonçaient l’avènement de Georgia Meloni. L’Espagne donc, comme ailleurs, se droitise. Le paysage politique se clive. Le Parti populaire, conservateur et libéral, gouverne villes et régions avec le parti d’extrême-droite Vox, peut-être même poursuivra-t-il cette alliance au sein du gouvernement central (on le saura aux élections générales avancées au 23 juillet prochain). Le Centre (parti Ciudadanos) s’est vaporisé. La social-démocratie, incarnée par le PSOE, traverse un trou d’air même si Pedro Sanchez, présent aux manettes depuis 2018, matraque son bilan : plusieurs lois sociales et une croissance qui caracole à +5,5 % en 2021 et en 2022.
À la gauche de la gauche, les plateformes citoyennes de 2015 et 2019 ont visibilisé, institutionnalisé, expérimenté des agendas de rupture avancés par des groupes écologiques, communistes, alternatifs, anarchistes, régionalistes, parfois indépendantistes (catalans et basques). Elles ont administré la vie quotidienne de 6 millions d’habitants (si on compte les villes où elles ont gouverné en propre) et même 9 millions (si on compte celles qui ont participé à des majorités intégrant des partis réformistes de gauche dont le PSOE). Faire leur bilan, par ailleurs positif sur des dossiers majeurs (logement social, participation, protection de l’environnement…), est sans doute moins intéressant que comprendre pourquoi elles sont
