À quelles conditions fait-on durer nos biens domestiques ?
En mai 2023, la mairie du 14e arrondissement de Paris a lancé une opération de collecte de téléphones mobiles : les résidents ont reçu une enveloppe préaffranchie pour donner gratuitement leurs anciens portables. Ces appareils sont ensuite remis en état par un atelier d’insertion, puis redistribués via Emmaüs[1]. Avec cette opération, ils leur donnent une deuxième vie, afin que les téléphones soient utilisés par d’autres plutôt que remisés dans des tiroirs.
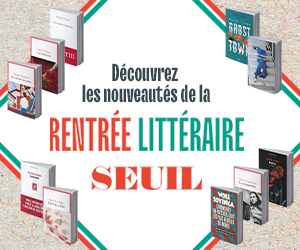
L’objectif est alors, de la part du gouvernement, d’encourager des pratiques individuelles qui permettent de faire durer les objets. Mais pour les encourager, il faut comprendre les conditions dans lesquelles ces pratiques s’exercent. Comment les individus font-ils durer leurs biens domestiques ? Qu’est-ce qui les contraint, ou au contraire les pousse à faire durer ?
Les réponses qui vont suivre sont le résultat de plusieurs années de recherche et d’une série d’enquêtes de terrain. Celles-ci réunissent des statistiques sur plus de deux-mille signataires d’une pétition contre l’obsolescence programmée, des entretiens menés au domicile d’une soixantaine de consommateurs, l’observation d’échanges autour de la longévité dans des collectifs en ligne (forums) et hors ligne (ateliers de réparation bénévoles), et l’analyse de discours publics, médiatiques, marchands et associatifs formulés sur la question de la longévité.
La longévité, un enjeu qui parle à (quasiment) tout le monde
La préservation et la conservation des objets est liée à un contexte de société de pénurie. Le cycle de renouvellement des produits était plus lent avant l’avènement de la consommation de masse, quand la production était limitée par les moyens techniques ou en période de guerre[2]. On fait aussi davantage durer les objets dans les pays dits « en développement », où les individus font preuve de créativité pour transformer des déchets en nouveaux objets[3]. Si cette question se pose à nouveau en France aujourd’hui, c’est en lien avec l
