Un féminisme incarné ou les bonnes manières d’incarner le féminisme ?
En dépit de décennies de lutte, les femmes ne disposent toujours pas librement de leur corps. C’est ce que rappelle sans cesse la nouvelle vague de mobilisations féministes qui, depuis maintenant plusieurs années, déferle dans le monde.
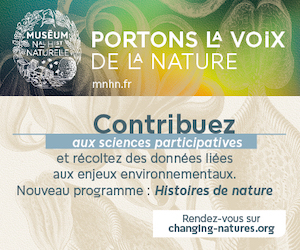
Les violences sexuelles, les attaques sur les droits reproductifs ou encore les entraves au plaisir féminin sont autant de limites à l’autonomie corporelle des femmes. Dénonçant les violences gynécologiques et obstétricales, des féministes soulignent que la sphère médicale est aussi un des lieux où se joue la dénégation de la maîtrise de leur corps par les femmes.
Elles réactualisent ainsi une critique de longue date du pouvoir médical[1]. Après des années d’intensification de l’encadrement médical de la santé des femmes[2], de la contraception à l’accouchement en passant par le frottis cervico-utérin régulier, ces militantes font à nouveau entendre des voix discordantes en questionnant le coût de la médicalisation. Le courant de self-help féministe rassemble ces voix contestant l’emprise médicale sur le corps des femmes. En développant un répertoire d’action original centré sur l’organisation d’ateliers de réappropriation du corps, il s’inscrit pleinement dans le renouveau féministe qui s’empare des questions corporelles. Ce faisant, le self-help féministe offre un observatoire privilégié des manières dont les féministes contemporaines luttent concrètement pour disposer librement de leur corps.
Analyser ces luttes permet de complexifier les conceptions du rapport des féministes au corps des femmes. Un soupçon d’essentialisme plane sur celles qui se saisissent de questions corporelles telles que les règles, l’accouchement ou la contraception : qu’elles s’intéressent au corps serait la preuve qu’elles entretiennent un rapport douteux au biologique et à la nature. Leur féminisme est aisément rattaché au différentialisme, historiquement incarné par le courant Psychanalyse et Politique, qui invite à célébrer le corps des femmes
