Comment l’Europe fabrique l’exclusion et la défiance des jeunes en migration
Après plusieurs heures de déambulations fiévreuses dans les rues de Barbès, on parvient enfin à retrouver Zaki pour lui annoncer la bonne nouvelle : ce soir, enfin, il aura un lit et une douche chaude. L’éducatrice de rue se réjouit, cela fait plusieurs jours qu’elle se bat pour lui garantir une place dans le centre.
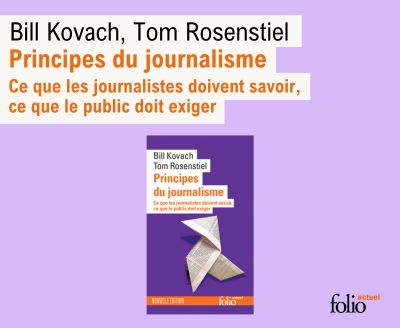
Mais l’adolescent n’accueille pas la nouvelle comme prévu. Il a un rendez-vous cette nuit, il négocie son heure d’arrivée dans le centre, non, 22 heures c’est trop tôt, il ne pourra pas. « Tu as besoin d’une douche, et il faut qu’un médecin voie ta blessure Zaki ». Il a la bouche pâteuse, les yeux vitreux, il a certainement pris un comprimé de Rivotril et le médicament le ralentit, il plane un peu. Les traces écarlates qui imprègnent le bandage sale à sa cheville laissent deviner l’infection qui arrive. L’air hagard, il réajuste son polo Lacoste élimé, un sourire navré se dessine sur son visage poupin et abîmé de cicatrices. Du haut de ses 14 ans à peine révolus et en équilibre précaire sur la béquille qui soutient sa jambe blessée, il hèle en arabe l’un de ses amis qui lui offre une cigarette. Il porte la Camel à ses lèvres, l’allume d’un geste sûr, savoure la première bouffée de nicotine et lance, avec malice et superbe : « c’est la liberté ».
À quelques kilomètres de Barbès où se retrouvent de jeunes marocains et algériens (et, plus sporadiquement, tunisiens) qui, comme Zaki, tendent à préférer la rue aux centres pour mineurs, des centaines d’autres jeunes étrangers dorment également dehors à Paris – comme dans de nombreuses villes françaises. Ceux-là sont notamment originaires de pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, et préféreraient au contraire les centres à la rue mais l’accès à la protection de l’enfance leur est refusé. Leur minorité d’âge et, partant, leur légitimité à être protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) sont mises en doute. Des lignes de démarcation et de fracture apparaissent, des frontières sociales, morales et rac
