Deux poids deux mesures, de l’Afrique au Moyen-Orient
Un des reproches majeurs à l’égard de la France exprimé partout en Afrique, et amplifié au Sahel du fait de l’actuel rejet populaire de l’ancienne puissance coloniale, est le « deux poids deux mesures ». La France a pratiqué une politique agressive d’admonestation et de rupture à l’encontre des régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger (lesquels n’ont d’ailleurs pas été en reste dans ce registre, il faut le reconnaître) tout en chérissant leurs homologues du Tchad et de Guinée, et en acceptant sans mot dire le coup d’État au Gabon.
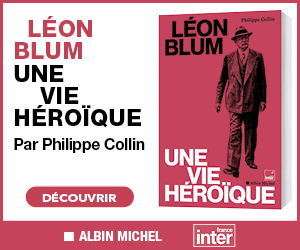
Elle avait même accueilli sans grand problème (d’aucuns y ont repéré un certain soulagement suite aux échecs du gouvernement élu alors en place) le premier coup d’État d’Assimi Goïta au Mali avant de se dresser vent debout contre « le coup d’État dans le coup d’État » du même Assimi Goïta quelques mois plus tard.
La dénonciation de ce « deux poids deux mesures » spectaculaire ne s’applique pas qu’à l’actualité, elle mobilise souvent le passé. Comment la France ose-t-elle donner des leçons de démocratie aux pays africains alors même qu’elle n’a jamais reconnu la violence de la conquête coloniale et le despotisme au quotidien de sa gestion des territoires qu’elle a occupé pendant des décennies (cf. l’indigne régime de l’indigénat auquel les peuples colonisés ont été soumis jusqu’en 1945) ? Une fois fini l’empire français, grâce en grande partie à la guerre d’indépendance en Algérie, elle s’est attribué un rôle de « gendarme de l’Afrique », depuis la répression sanglante de l’UPC au Cameroun au tournant des indépendance jusqu’à la guerre catastrophique contre Kadhafi, en passant par la fort douteuse opération Turquoise lors du génocide au Rwanda. Elle a ainsi multiplié les « opérations extérieures » (opex) menées par son armée, toujours au service de régimes amis ou aux dépens de régimes honnis, que ce soit pour protéger ses intérêts ou suivre les lubies de ses dirigeants. Tout cela apparaît à juste titre comme une pr
