Vote RN : pourquoi le racisme compte
Les enquêtes sur les motivations électorales individuelles soulignent dans leur majorité la centralité du racisme dans le vote pour le Rassemblement national (RN, ex-Front national). Les électeurs et électrices du RN se situent toujours aux sommets des « échelles d’ethnocentrisme » mises au point par la science électorale, qui mesurent l’ampleur, l’intensité et la récurrence des préjugés négatifs à l’encontre des minorités ethno-raciales[1].
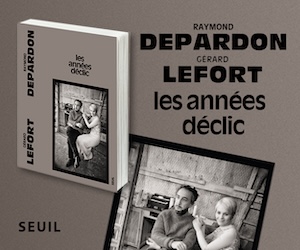
Ces instruments de mesure ne sont pas parfaits et présentent d’incontestables limites méthodologiques. Il n’en reste pas moins que les résultats qu’ils offrent, confirmés à chaque scrutin, doivent être regardés avec lucidité.
Cela n’est pas toujours le cas, y compris au sein d’une partie des travaux de sciences sociales sur le vote d’extrême droite, préférant mettre en avant d’autres causalités jugées davantage « sociales » – comme si le racisme n’était pas un fait proprement social, qui pouvait s’articuler à d’autres rapports sociaux.
Le racisme compte politiquement parce qu’il compte socialement
De 2016 à 2022, dans le cadre d’une enquête de terrain dans le sud-est de la France, j’ai mené des entretiens auprès d’électeurs et d’électrices ordinaires ayant déjà, ponctuellement ou régulièrement, déposé un bulletin « FN » ou « RN » dans l’urne. J’ai cherché à connaître leurs trajectoires de vie, leurs conditions matérielles d’existence, leurs jugements sur les façons dont le monde social fonctionne et devrait, à leurs yeux, fonctionner.
L’analyse des schèmes racistes structurant les discours récoltés s’est dès lors assez vite imposée comme incontournable. Sans réduire leurs propos à cette seule dimension, il n’en reste pas moins que le racisme y apparaissait, pour reprendre les mots du sociologue Stuart Hall, comme une « manière effective d’ordonner le monde » et « d’organiser l’action au quotidien »[2]. Le racisme possède une force sociale qui lui est propre, qui oriente les goûts et les dégoûts sociaux, et par continui
