Kanaky-Algérie : Macron face au colonial
Alors qu’en 2017, Emmanuel Macron se proposait de confronter la société française à son passé colonial, l’analyse de ses déclarations et de sa politique, sur l’Algérie comme sur la Kanaky, montre que le fait colonial reste un impensé chez le président de la République.
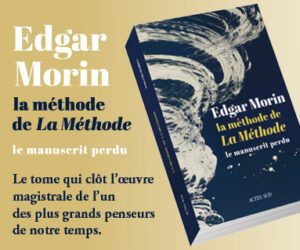
Pourtant, sa déclaration du 14 février 2017 qualifiant la colonisation de crime contre l’humanité a constitué l’un des faits marquants de sa campagne pour l’accès à l’Élysée. Elle lui permettait de se placer en homme providentiel, né après la période coloniale, comme délesté de ce poids, et d’incarner le nouveau monde capable de se confronter à ce passé pour projeter la France dans la mondialisation. Cette déclaration était suivie d’autres comme celle prononcée au Burkina Faso en novembre 2017, sur les crimes coloniaux et la promesse de restituer le patrimoine africain, qui allait dans le même sens : il pouvait, lui, engager enfin la France vers son dépassement colonial.
Ces promesses ont été suivies de nombreux gestes sur le passé algérien. De 2017 à 2022, Emmanuel Macron est à l’origine de 19 actes mémoriels dont les plus marquants restent la reconnaissance de la responsabilité de l’État dans l’assassinat des militants indépendantistes Maurice Audin et Ali Boumendjel, une politique de réparations pour les harkis et leurs familles et la commande d’un rapport à l’historien Benjamin Stora sur « les questions mémorielle portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie ». En 2021, l’Élysée recrute une directrice de projet « mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie ».
Pourtant, la colonisation est demeurée la grande oubliée de la politique mémorielle d’Emmanuel Macron.
Les actes mémoriels du quinquennat se concentrent exclusivement sur la guerre d’Algérie en éludant sa dimension coloniale. Seule la restitution de crânes de résistants algériens du XIXe siècle se révélant être ceux d’autres personnes, ou l’érection de la stèle en l’honneur de l’émir Abdelkader à Amboise concernent la
