Travailler sur les graffitis de prison, est-ce vraiment sérieux ?
Considérer les maisons d’arrêt et ce qui s’y déroule par l’étude de leurs graffitis permet-il vraiment de comprendre le milieu carcéral ? Certainement pas si l’on y recherche des figurations esthétiques ou des expressions écrites singulières : des œuvres ou des bons mots pourrait-on dire. Or, ce ne sont là que quelques spécimens de graffitis, exceptionnels, dont le choix magnifie surtout leurs auteurs. Sont-ils représentatifs ? Rien n’est moins sûr.
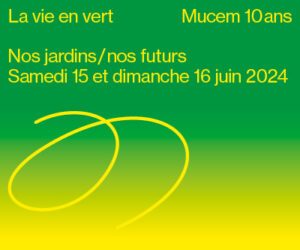
C’est pourtant avec cet a priori de la part des administrations que j’ai pu entrer jusque dans les cellules : parce que ma demande semblait annonciatrice d’une exposition ou d’un recueil des graffitis les plus éloquents ; parce que mon choix pouvait valoriser les établissements par la qualité expressive de certains de leurs pensionnaires. On imaginait en quelque sorte que je venais capturer quelques productions graphiques hors normes. Ce qui signifiait aussi que le travail du chercheur était conçu comme dénué de toute préoccupation sur le contexte même des graffitis.
Préalablement, j’avais d’ailleurs demandé aux directions de ces établissements de me dire ce qu’étaient ces graffitis. Les réponses avaient été succinctes : « peu poétiques » pour l’une, « des insultes » pour l’autre, « la libération, leur quartier, la société » pour la troisième : rien de précis qui puisse s’avérer un préalable à ma recherche ; juste des catégories que tout un chacun imagine lorsqu’il est question de graffitis de prison. Encore évitais-je les poncifs que relaient les romans ou la bande dessinée car il n’est pas un volume dont une scène de prison ne s’accompagne pas d’inscriptions murales : personnages au graphisme sommaire, pendus, femmes érotisées, formules bravaches, décomptes du temps, etc. Parfois même, les énoncés de la littérature sont totalement hors contexte : « vive la classe » ou bien « interdit d’interdire » ne peuvent pas appartenir au répertoire carcéral.
Il me semblait donc que l’on ramenait ces graffitis à un tout h
