Comment rompre avec le culte de l’innovation ?
Dernière vague d’innovation qui promet de changer nos vies : l’intelligence artificielle (IA) générative. Dans un article de L’Usine Nouvelle, daté du 31 juillet dernier, le magazine explique comment les entreprises forment leurs salariés à cette nouvelle technologie. Fini les hackatons, place au promptathlon. Un événement où les salariés sont invités, pour relever un défi, à rédiger des prompts, ces requêtes envoyées aux IA génératives pour qu’elles génèrent des textes, des calculs, des images ou des vidéos.
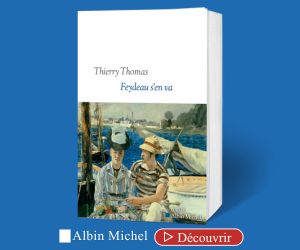
Pour les promoteurs de cette nouvelle technologie, les potentiels de cette innovation sont immenses grâce aux données massives désormais disponibles en ligne et à des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Elle constituerait désormais un outil indispensable pour l’aide à la décision et à la créativité, les prévisions, les études marketing, l’amélioration de la performance opérationnelle voire… l’accélération de la transition écologique.
Cet exemple ne fait qu’illustrer la croyance, ancrée dans nos sociétés avancées, dans les bienfaits de l’innovation technologique pour résoudre tous les défis sociétaux ou économiques du moment : santé, environnement, croissance, agriculture, etc.
Ce biais pro-innovation avait déjà été pointé du doigt en 1962 par le sociologue Everett Rogers[1]. Il indiquait que l’on met systématiquement en avant les bénéfices supposés de l’innovation mais qu’on laisse de côté ses effets négatifs éventuels à moyen et long terme. Ce biais n’a fait que se renforcer au fil des décennies. Toujours connotée positivement, l’innovation a désormais colonisé toutes les sphères de la vie économique et sociale comme l’atteste la floraison des épithètes accolés à la notion : technologique, verte, sociale, culturelle, pédagogique, managériale, financière, etc. Ainsi, l’innovation est devenue un culte, constamment célébré.
Ce culte de l’innovation se nourrit de trois mythes : un mythe économique selon lequel l’innovation est la condition de la cr
