Le droit électoral, enjeu de la présidentielle américaine
Depuis une dizaine d’année, l’arrivée de Donald Trump dans la vie politique étatsunienne a mis à mal, peu ou prou, toutes les institutions du pays. Le droit électoral et l’administration des élections, perçus comme des outils de conquête de pouvoir, sont mis à rude épreuve par le Parti républicain.
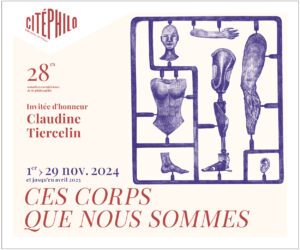
Le caractère archaïque du mode de scrutin américain donne un avantage partisan à la version trumpiste du parti. Un candidat tel que Donald Trump ne pourrait prétendre à la Maison Blanche sans le système du Collège électoral favorisant les petits États ruraux, et sans un scrutin à un tour dans lequel une simple pluralité des voix permet de l’emporter[1]. Ce scrutin aberrant rend possible l’élection d’un candidat qui n’a pas obtenu la majorité du vote populaire.
Ce fut le cas pour Trump en 2016 lorsqu’il obtint 46,1 % des suffrages[2]. Même avec le taux de participation historique de 2020, Donald Trump a atteint péniblement 46,8 % du vote populaire. Il l’a perdu de sept millions de voix – mais seules 44 000 voix en Géorgie, en Arizona et dans le Wisconsin auraient suffi à obtenir une égalité dans le Collège électoral. En théorie, un candidat démocrate peut gagner le vote populaire de six points et perdre le Collège électoral.
Donald Trump est donc un candidat minoritaire, qui ne pourrait pas être élu dans un autre système électoral. Son parti, bien conscient de ses limites, entend profiter de tous les avantages envisageables dans un système électoral complètement décentralisé.
De même, l’ancien président a pu asseoir son emprise sur l’évolution politique du pays, et ce pour plusieurs décennies, en nommant trois juges à la Cour suprême (et de très nombreux juges fédéraux). Les positions ultra-conservatrices de la nouvelle majorité à la Cour suprême ne représentent pas la position de la majorité du peuple américain. Cette évolution vers la droite de la plus haute instance judiciaire du pays, et qui est censée faire preuve de neutralité, n’est possible que parce que
