Un paysage économique suspendu – Liban (1/2)
Plus rien ne permet de la célébrer aujourd’hui, ni la situation actuelle, ni ses effets limités entre temps : il y a cinq ans le Liban connaissait pourtant une vague de mobilisations pleine d’espoir – un événement à l’anniversaire impossible au moment où les activistes et sympathisant.e.s de l’époque sont lancés dans une course humanitaire contre la montre (du moins celles et ceux resté.e.s dans les dizaines de milliers d’émigré.e.s par an dont une majorité ont entre vingt-cinq et trente-cinq ans) ; au moment aussi où d’autres pans d’histoire, plus menaçants, ressurgissent dans le débat public libanais.
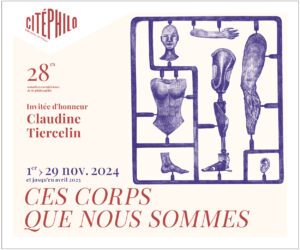
Une frontière était pourtant en train d’être franchie autour de ce 17 octobre 2019 : la moitié de la population n’avait désormais pas vécu ou était à peine née pendant les guerres de 1975-1992[1]. Pour les jeunes mobilisé.e.s alors, non seulement ces guerres n’appartenaient plus à un vécu direct, mais le souvenir des grands moments et de grandes mobilisations passées – retrait israélien en 2000, manifestations et retrait syrien en 2005 – appartenait à leurs parents. La précédente guerre de 2006 avec Israël était même lointaine pour un/e jeune autour de la vingtaine n’ayant jamais eu « sa » mobilisation.
Ce discret changement structurel[2] rencontrait le climat de ras-le-bol de l’époque, avec l’invention soudaine d’une taxe sur WhatsApp (le principal mode de communication dans le pays), dans la foulée d’un été de coupures de courant et feux de forêts scandaleux. La mémoire encore vive d’un précédent mouvement en 2015 (portant sur la gestion catastrophique des ordures), assortie de l’essor de nouvelles initiatives politiques dans la foulée, complétait ce paysage avec possibles.
Le passage était symbolique dans un pays où la mémoire de ces guerres est discutée depuis bientôt trente ans, avec des hommes politiques indéboulonnables dont l’ascension s’est faite dans et par la guerre. Personne il y a cinq ans n’aurait parié sur leur maintien jusqu’à aujourd’
