Les États-Unis ou la confusion des points de vue
Fin septembre, le journal Le Monde consacrait un long article à la ville de Springfield, dans l’Ohio, une ville récemment stigmatisée par Donald Trump, dont les habitants, d’après ses « informations », mangeaient les chats et les chiens.
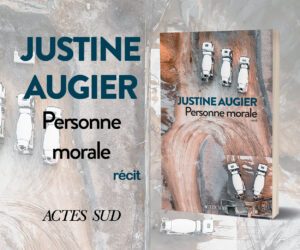
L’article en question ne s’attarde pas sur cette pure invention, mais donne surtout la parole à la population haïtienne installée à Springfield au cours des dix dernières années, qui représente aujourd’hui un quart de la population de la ville. Article passionnant à bien des égards, mais qui contient une phrase pour le moins étonnante : « La ville s’est transformée en laboratoire des États-Unis, en miroir de ses angoisses et de sa polarisation incandescente. » Comment cette situation locale particulière, caractérisée par une modification substantielle de la population en un temps relativement court, pourrait-elle être un « laboratoire » de phénomènes observés à l’échelle du pays ?
Quelques semaines plus tôt, le même journal consacrait cette fois un long article à Brownsville, ville du sud-ouest du Texas, où Elon Musk a installé sa base SpaceX. Là aussi, le reportage est très intéressant, plus instructif que la plupart des articles consacrés à la campagne électorale, mais la réduction de la focale à cette ville située près de la frontière mexicaine est toujours justifiée par sa fonction d’illustration d’un mouvement plus général : « Le destin de la ville de Brownsville offre un démenti de la lecture qui prévalait à propos des États-Unis après la grande crise financière de 2008 et avant l’élection de Donald Trump en 2016, soit celle d’un pays en voie de paupérisation et de désindustrialisation. Depuis 10 ans, l’Amérique a changé, se couvrant d’usines et profitant d’une énergie très abondante – le gaz et les renouvelables – tandis que les bas salaires remontent la pente. Insensiblement, les Américains ont retrouvé l’esprit pionnier. » Or, on pourrait sans peine montrer que de nombreuses régions n’ont pas bénéficié de ce rebon
