L’Allemagne ou le pays des illusions brisées
Depuis le milieu des années 1980, le passé nazi n’a jamais plus réellement quitté le devant de la scène en RFA, même après la disparition des générations qui avaient vécu le nazisme. Les entrepreneurs de mémoire, qu’ils soient historiens, journalistes, artistes, responsables politiques ou juges, ont construit un modèle mémoriel global jugé exemplaire au sein du monde occidental et qui repose sur trois piliers : la vérité historique et le traitement scientifique des archives par des institutions de recherche (extra-)universitaires ; la criminalisation de toute forme de négationnisme à l’aide du droit conçu comme une arme de combat contre le négationnisme ; la reconnaissance politique des responsabilités, c’est-à-dire des crimes et des souffrances infligées, ouvrant par la même la voie à des réparations financières ou symboliques.
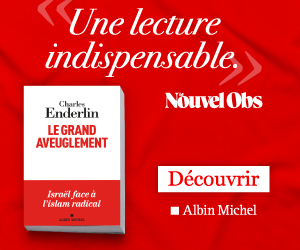
Ce modèle s’est d’abord construit par souci de ce que pensent les autres pour finalement s’imposer comme un élément-clé de la culture politique allemande.
Illusion n° 1 : une mémoire négative performative
Ce paradigme de la Vergangenheitsbewahung (Aleida Assmann) renvoie moins à la nécessité de se confronter au passé que de le préserver et de l’actualiser. Ce double souci politico-civique érigé en devoir sacré a constitué le fondement de l’identité nationale de l’Allemagne unifiée, mais aussi sa manière de se présenter au monde : la formule « Nie wieder Auschwitz » a remplacé le « Nie wieder Krieg » [respectivement Plus jamais Auschwitz et Plus jamais la Guerre, ndlr]. Au XXIe siècle, les forces politiques allemandes relevant de l’art républicain considèrent qu’elles n’ont pas le choix d’oublier le passé nazi. Elles estiment que cette mémoire négative est même constitutive de la communauté politique et qu’elle lie les citoyens allemands dans leur rapport au passé, au présent et à l’avenir.
Cette mémoire officielle fut parallèlement prise en charge par des acteurs issus de la société civile à l’instar de la journaliste Lea Rosh, por
