Critiquer le capitalisme, être vertueux sur le marché – une antinomie
Les pratiques actuelles de consommation éthique sont fréquemment critiquées pour les possibilités accrues d’accumulation du profit qu’elles représentent (en particulier ce que l’on nomme le greenwashing, le pinkwashing, etc.), ou bien par le prisme du manque de consistance éthique de ses tenants – portrayés comme des bourgeois bohèmes friands d’hôtels écoresponsables vers lesquels ils s’envoleraient sans remords en Airbus.
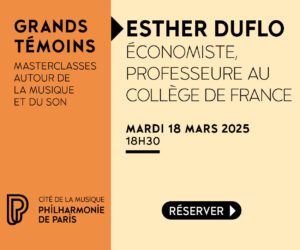
Aborder la consommation éthique par ce biais, c’est concentrer l’attention sur la pureté des intentions des différents acteurs, entreprises proposant malhonnêtement des indulgences, et consommateurs ne parvenant pas à résister à l’hubris de la possession ou de la distinction. Voilà une manière de passer à côté de l’essentiel du problème.
Admettons la chose suivante : le consommateur responsable est un sujet moral, sincèrement préoccupé d’autrui, le percevant comme vulnérable à ses actes d’achat, comme exposé à la puissance d’agir qu’il déploie sur le marché. D’abord parce que c’est probablement vrai, même si ses gestes s’accompagnent, comme tous les positionnements moraux, de motifs troubles ou doubles et de petites et de grandes compromissions. Surtout, parce que la pureté des intentions morales au principe d’une conduite de consommation ne change rien à ce qui est réalisé dans et par la série d’achats qu’elles déterminent. Elles contribuent à constituer le monde à l’image du marché. Celui-ci prétend à la totalité, colonisant les catégories, les formes de pensée, les conduites, les corps. Il y parvient désormais par le biais des tentatives qui lui sont opposées de le corriger ou de l’amender.
La consommation éthique est très certainement une critique du capitalisme, à l’échelle de la vie quotidienne ; or, elle ne fait pas qu’échouer en tant que critique, elle collabore à l’ordre même qu’elle s’efforce de corriger. Les pratiques qu’elle rassemble ne sont pas seulement vaines, elles concourent à la solidification d’une totalité sociale dé
