Agenda anti-immigration et statistiques publiques
Le 9 février dernier, l’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID) publiait un étonnant rapport, intitulé « L’immigration d’Asie du Sud-Est en France : une trajectoire remarquable d’intégration ». Ce dernier est immédiatement relayé par Le Figaro, qui s’empresse de reprendre le poncif de la « minorité modèle », vantant un « modèle d’une intégration réussie et d’une immigration vertueuse ».
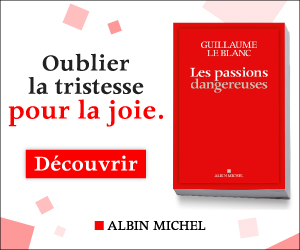
Né en 2020, l’OID est en fait un think tank, dirigé par le très médiatique Nicolas Pouvreau-Monti. À l’origine de sa fondation, un groupe de trentenaires très conservateurs, passées par l’IEP de Paris, l’École polytechnique ou l’Essec. Très marqué à droite, le think tank fournit notamment des argumentaires clefs en main aux parlementaires de droite et d’extrême-droite. Derrière des termes qui donnent l’apparence de la scientificité, on trouve en effet un agenda sans ambigüité anti-immigration. Sous l’onglet « Culture et religion », on trouve par exemple 8 publications. Outre une note consacrée à un retour sur les conférences que l’OID a organisées fin 2024 au Parlement, toutes concernent l’immigration en provenance du Maghreb et de Turquie, l’islam ou encore l’asile. Une des publications est éloquemment titrée « Quand la diversité ethnique augmente, la confiance sociale baisse ». La dernière en date porte donc sur l’immigration en provenance d’Asie du Sud-Est.
À chaque fois, la structure est assez similaire : des chiffres et statistiques habilement articulés dans un plan à l’apparence anodine, et surtout, jamais sociologisés, c’est-à-dire ni contextualisés, ni expliqués.
Les chiffres ne parlent pas d’eux-mêmes
Encore faut-il rappeler que les chiffres, aussi exacts soient-ils, ne parlent jamais d’eux-mêmes. Prenons par exemple les écarts de réussite scolaire entre filles et garçons. Les filles sont, de manière générale, meilleures à l’école, elles réussissent mieux le bac, mènent des études plus longues et sont plus souvent diplômées du supérieur, et ceci es
